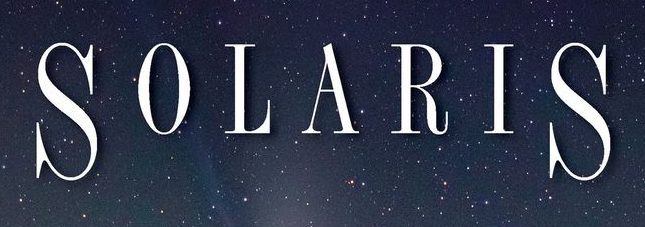Lectures 1998
1998: Solaris 125-128
Solaris 125
Charles de Lint
Trader
New York, Tor, 1997, 464 pp.
Voici un auteur canadien qui ne cesse de charmer et d’envoûter ses lecteurs. Un des pionniers de la fantasy urbaine, Charles de Lint s’est taillé un pays à sa convenance en créant la ville de Newford quelque part dans une Amérique du Nord qui ressemble beaucoup à la nôtre. Après avoir figuré de manière proéminente dans Memory and Dream, ainsi que dans plusieurs autres textes, Newford sert de cadre à l’étrange aventure de Max Trader dans ce livre. Car, un beau matin, le luthier Max Trader, artisan accompli qui trouve sa vie un peu stérile, se réveille dans la peau de Johnny Devlin, un charmeur sans grandes qualités.
Du coup, Max doit assumer les dettes accumulées par Devlin, dettes qui sont à la fois financières et sentimentales. S’il ne peut pas faire face aux premières et se retrouve bientôt à la rue, Max, dans la peau de Devlin, ne manquera pas de faire meilleure impression que son prédécesseur dans le même corps… Malgré tout, il saura susciter la sympathie de Tanya, actrice manquée que Devlin avait exploitée, de Zeffer, une compositrice-interprète montante, et de Lisa, adolescente fugueuse.
Pendant ce temps, Devlin ne saura profiter de sa fortune inopinée. Même s’il a endossé la peau de Max Trader, accédant à la jouissance d’une situation confortable, il se retrouvera vite sur une mauvaise pente, une fois de plus. Le point culminant de cet échange de corps n’aura pas lieu dans le monde prosaïque de Newford, mais dans le monde des esprits aux portes ouvertes par le personnage de Joseph Crazy Dog – car les Amérindiens font partie intégrante de l’univers de Charles de Lint.
Comme toujours chez de Lint, ses personnages sont profondément humains et aisément reconnaissables. L’auteur excelle à décrire un milieu de jeunes artistes en devenir, de jeunes gens attachants et de marginaux qui hantent les frontières du prosa que et du fantastique, à tous les niveaux. En fin de compte, sans s’attarder à des effets de style ou tenter de raconter des épopées héroïques, de Lint séduit en nous faisant entrer de plain-pied dans des existences un peu plus simples, un peu plus limpides, un peu plus pures. Après avoir évoqué l’attrait nostalgique du préraphaélisme dans Memory and Dream, il nous convie à partager l’éternelle recherche de l’authenticité des jeunes et des artistes.
Bruce Sterling
Holy Fire
New York, Bantam Books, 1996, 358 pp.
Dans un genre nettement différent, Sterling explore aussi la quête de l’expression personnelle chez les jeunes et les artistes d’un futur proche qui ne semble pas tout à fait étranger. Mia Ziemann, à la toute fin du vingt-et-unième siècle, est elle-même sur le point d’être centenaire. Elle a mené une vie très sage et très mesurée, qui l’a rendue riche et assurée des meilleurs traitements médicaux.
Poussée par un soudain dégoût pour sa vie devenue trop tranquille, elle décide de procéder à sa première régénération, mais le traitement fonctionne trop bien. Sa nouvelle jeunesse insuffle une vigueur inattendue à son insatisfaction, l’incitant à s’enfuir en Europe où elle rejoint vite des jeunes insoumis qui la prennent pour l’une d’entre eux.
Sterling décrit l’Europe que les Européens, riches ou pauvres, aiment montrer aux Américains. Une Europe cosmopolite, à la mode et pourtant branchée sur ses propres traditions. Une Europe sans pauvres et autres hors-castes que les Gitans. Si c’est l’Europe du futur, c’est peut-être celle rêvée par Le Pen.
Toutefois, la science-fiction de Sterling s’intéresse surtout au conflit qui dresse les vieux contre les jeunes dans un monde où les vieux contrôlent toutes les richesses et sont les seuls à influer sur le destin du monde. La question au centre de Holy Fire, c’est de savoir comment transcender l’utopie: le monde décrit dans le roman est parvenu à réaliser un certain idéal de confort et de sécurité pour tous, mais au prix d’écarter les jeunes de tout rôle significatif. En essayant de combler le vide dans leurs vies, les jeunes se rebellent contre un monde qui n’impose rien mais qui ne leur offre rien.
Sterling conclut sur une note d’espoir, sur un appel à renoncer d’une certaine façon à la virtualité, ce qui peut paraître ironique de la part d’une figure emblématique du mouvement cyberpunk. Toutefois, ceux d’entre nous qui ont retenu du cyberpunk qu’il était encore possible de révolutionner la science-fiction se rangeront plus volontiers du côté de Sterling que de celui de Gibson. Là où Gibson se cantonne désormais dans l’exploitation d’un style, Sterling joue encore avec des idées – au risque d’avoir à brûler ce qu’il a adoré.
Brenda Clough
How Like A God
New York, Tor, 1997, 288 pp.
Un peu comme dans le roman Trader de Charles de Lint, Brenda Clough raconte l’aventure d’un homme ordinaire, Rob Lewis, dont la vie bascule un matin de façon inexplicable. Au lieu de changer de peau, il acquiert des pouvoirs quasi divins. En quelques jours, il découvre qu’il est capable de lire les pensées des gens autour de lui, d’influencer leurs esprits et de contrôler tant leurs perceptions que leurs actions. L’expérience est si terrifiante qu’elle le fait fuir jusqu’à New York, où ses nouveaux pouvoirs lui permettent de survivre à la manière d’un parasite dans les rues de la métropole. Mais l’isolement le pousse à chercher l’amitié d’autrui et c’est ce qui finira par le sauver.
On s’habitue si facilement aux épopées cosmiques, aux intrigues multiples et complexes, que ce roman désarçonne quelque peu. L’intrigue occupe une année bien remplie et se concentre sur les transformations d’un seul protagoniste. Le conflit avec le seul autre détenteur des mêmes pouvoirs est rapidement réglé, car c’est l’adaptation de Rob Lewis à ses nouveaux pouvoirs qui est au coeur du roman. Il s’agit en définitive d’un roman extrêmement sympathique, enraciné dans la vie quotidienne des états-Unis, et qui plaira aux amateurs du thème du surhomme, traité cette fois sur le mode fantastique dans le cadre d’une intrigue linéaire.
Solaris 126
David Brin
Brightness Reef
New York, Bantam Books, 1995, 659 pp.
Infinity‘s Shore
New York, Bantam Books, 1996, 644 pp.
Ces deux premiers volumes d’une nouvelle trilogie donnant suite à Startide Rising sont tout à fait passionnants. Dans le premier tome, Brightness Reef, l’auteur nous présente Jijo, un monde laissé en jachère par la civilisation intergalactique récemment découverte par les humains. Cependant, une petite portion de la planète a été colonisée en douce par plusieurs espèces intelligentes, les humains arrivant en dernier lieu. Ces différentes races ont appris à coexister pacifiquement mais vivent dans la hantise d’un retour des Galactiques. La région habitée, qui a pour nom "the Slope", n’est pas sans rappeler d’ailleurs par sa situation géographique les états-Unis de 1776, tout comme la composition hétérogène de sa population. Cependant, Brin n’écrit pas une allégorie, même s’il célèbre les vertus de l’unité dans la diversité et même si la culture étatsunienne, apportée par les humains, a fini par influencer la culture des autres races présentes sur Jijo…
Or, comme le craignaient depuis longtemps les colons de Jijo, les Galactiques retournent à l’improviste, mais les habitants de Jijo se rendent bientôt compte que le souci primordial de l’expédition en visite n’est pas de châtier leur infraction aux règles de la bonne conduite intergalactique. En fait, les Galactiques recherchent un vaisseau en fuite, le Streaker, qui a effectué une découverte bouleversante. Un vaisseau opéré par un équipage d’humains et de néo-dauphins en provenance de la Terre…
La solidarité des six races de Jijo sera mise à rude épreuve par leur soudaine implication dans les méandres d’un conflit intergalactique. Grâce à une ribambelle de protagonistes divers, Brin se permet de nouer plusieurs intrigues entretissées à l’échelle de la planète. Si cette technique ralentit énormément la narration, elle entretient un suspense indéniable, de rebondissement en rebondissement. Heureusement, Brin sait ménager des surprises de bon aloi.
Le lecteur lisant à la file ces deux volumes aura avantage à sauter les trente premières pages du second tome, Infinity’s Shore, presque entièrement vouées à la récapitulation des événements du premier tome. Dans ce deuxième livre, l’affrontement se précise entre les principaux ennemis de la Terre, les Jophur, et les occupants du Streaker, qui ont bel et bien trouvé refuge sur Jijo. La lutte semble inégale, mais l’ingéniosité des colons et des Terriens alliés pour le meilleur et le pire leur permet de combattre la haute technologie des Jophur. Et réservera à ces derniers quelques déconvenues…
Bref, Brin démontre une fois de plus sa maîtrise du space-opéra moderne. Brin s’y entend pour allonger la sauce, mais le cadre vaut le détour: l’unification culturelle de races fort diverses sous des auspices très américains donne des résultats parfois délicieusement divertissants, comme lorsqu’il décrit une bande de jeunes aventuriers inspirés par les romans de Mark Twain et Arthur C. Clarke! Bref, les personnages sont sympathiques, mais cette paire de romans vaut surtout par le foisonnement d’idées originales – ou du moins astucieusement renouvelées. Inutile de chercher des innovations formelles ou conceptuelles, mais les lecteurs à l’affût de spéculations rigoureusement menées ne s’ennuieront sans doute pas.
En attendant de voir si Brin résoudra toutes les énigmes dans le dernier volume de la trilogie…
Wildy Petoud
Tigre au ralenti
Le Plessis-Brion, Destination Crépuscule, 1997, 204 pp.
Voici un livre qu’on a envie de se remettre à lire aussitôt après l’avoir fini. Pour voir si on y comprendra quelque chose cette fois. Pour voir si l’écriture restera aussi percutante, si chaque mot fera toujours l’effet d’une braise ardente posée sur la langue par un ange. Pour voir si on aura encore envie de le relire après l’avoir terminé une seconde fois.
On pourrait croire que la science-fiction ne saurait être plus grandiose qu’en jonglant avec les étoiles et les nébuleuses dans les grands romans de space-opéra. Erreur. Wildy Petoud démontre superbement que la science-fiction peut transcender un cadre aussi étriqué à condition de transformer ses personnages habituels en acteurs cosmiques, aux prises avec les grandes constantes de l’existence et de l’univers: le temps, la souffrance, la causalité…
Au gré de chapitres déroutants et de scènes saisissantes, l’histoire nous présente le Bluesman, Minuit, Terrapin Flyer, des personnages déchirés, multiples, dotés de pouvoirs extraordinaires, dont les rencontres se traduisent souvent par des affrontements réciproques qui peuvent tout aussi bien trahir la quête d’une rédemption profondément individuelle… L’action habite quelques lieux privilégiés, dont la cité belle et terrifiante de Streganomm superbement chantée par BiyalaLune et les décors de Genève, endroit et envers.
Les chassés-croisés de la narration et les envolées de la prose frisent parfois l’abscons bien inutilement, mais chaque prouesse, chaque voltige de l’auteure a le mérite d’une absolue clarté tant qu’elle dure, avant la chute, avant un nouvel essor. C’est la superposition (quantique?) des histoires qui brouille peut-être notre lecture avant que l’observateur détermine quelle histoire exactement il a lu… Car un texte trop transparent peut aussi être insubstantiel; dans Tigre au ralenti, on sent une ferme volonté de cohérence, sinon logique du moins artistique, et le lecteur capable de s’en contenter trouvera dans ce roman de multiples joies, même au c ur de l’obscurité.
Petoud joue avec le temps et l’identité de ses personnages comme on l’a déjà fait avant elle dans la science-fiction française, mais elle apporte un tel élan jubilatoire à l’exécution de ses acrobaties narratives qu’elle réduit les expériences d’un Jeury au rang de pénibles exercices signé par un élève trop appliqué. C’est cette dimension ludique, cette invitation à zigzaguer dans le temps et l’espace avec Minuit, Terrapin Flyer, Star, Merrour et le Bluesman qui fait de la lecture de Tigre au ralenti un réel plaisir, surtout si on sait apprécier les mystères – du moins la première fois.
Si vous avez aimé Lost Highway de Lynch (moins son psychologisme trouble), si vous appréciez les visions éclatées d’un (William S.) Burroughs, vous ne risquez pas de dévirer, comme on dit par chez moi, en abordant Tigre au ralenti. Mais si vous préférez une histoire bien linéaire, où les personnages se rangent dans deux camps opposés, ne vous aventurez dans les pages de ce livre que si vous êtes prêt à danser sur une corde raide coupée en son milieu…
Rita Donovan
The Plague Saint
Edmonton, Tesseract Books, 1997, 155 pp.
Ce roman d’une auteure canadienne jusqu’à présent inconnue bénéficie d’une écriture remarquable, qui rappelle la prose onctueuse de Michael Ondaatje. Le début du livre, qui s’attache à la fuite de Lily Dalriada, est prenant. Dans un monde dévasté par une maladie mortelle, la conception et la naissance naturelles sont devenus des crimes afin d’entraver la propagation de cette maladie. Or, Lily a commis l’erreur de mettre au monde une fille, conçue de la bonne vieille façon. Exilée parmi les stigmatisés et les futurs pestiférés, Lily décide de fuir en confiant sa fille aux bons soins d’une amie.
Elle traverse un pays métamorphosé, s’accordant parfois des détours dans les mondes de sa mémoire et de son imagination. L’enfance de sa fille et la Florence des grandes pestes. Mais nul ne peut échapper à l’emprise des nouveaux fanatismes. Même si elle a le don de transformer les trahisons en loyautés, Lily finit par être capturée. L’église des Survivants veut se servir d’elle; l’église a besoin d’une sainte de la nouvelle peste.
Dans une certaine mesure, c’est un roman qui additionne les qualités sans jamais en faire la somme. Les réminiscences de Lily sont fascinantes. Ses plongées dans une Florence virtuelle sont passionnantes. Sa torture aux mains de l’église retourne le coeur. Le tableau des caractères et des tempéraments des personnages secondaires est sans faiblesse et d’une agréable originalité, plus souvent qu’autrement. Lily est courageuse mais humaine; elle voit clair en elle-même sans être omnipotente; bref, elle est une héro ne attachante.
Pourtant, sa trajectoire semble gratuite. Il manque au récit un minimum d’unité, ce petit élan qui emporterait le lecteur jusqu’à la conclusion. Espérons que le prochain romain de Rita Donovan formera un tout organique, vibrant de la tension qui redouble l’intérêt d’une bonne intrigue, car c’est tout ce qui lui manque pour faire sa marque sur la SF canadienne.
Notons en terminant une splendide couverture de l’artiste canadien Evergon.
David Nickle et Karl Schroeder
The Claus Effect
Edmonton, Tesseract Books, 1997, 241 pp.
En 1993, Nickle et Schroeder avaient remporté le Prix Aurora de la meilleure nouvelle en anglais pour "The Toy Mill", une féroce et jouissive démolition en règle de la légende du Père Noël. Ils ont fait de cette même nouvelle la première partie d’un livre qui se dévore comme une bande dessinée. L’histoire commence donc en 1983 lorsque Emily, qui voulait être enrôlée au nombre des lutins du Père Noël, voit son v u exaucé. Cependant, une fois rendue au pôle Nord, la jeune Emily découvre que le Père Noël est un cruel exploiteur du labeur des lutins, qu’il distribue les mauvais cadeaux aux enfants parce qu’il n’a pas la moindre idée de leurs véritables désirs et, pire, qu’il a pour idéal de répandre l’affliction. Seule la Mère Noël était parvenue à détourner son époux de cette voie en le convainquant que les enfants détestaient leurs cadeaux. Emily croyait bien avoir mis fin aux agissements du Père Noël, mais, en 1991…
The Claus Effect emporte le lecteur à la vitesse infernale du noir traîneau du Père Noël, dans les cieux, sur la banquise et sous terre. Pendant que des commandos de lutins s’efforcent de capturer Emily, le jeune soldat étatsunien Neil Nyman commet l’erreur de s’aventurer dans les ruines d’une certaine usine de jouets au pôle Nord… et de ramasser en chemin l’ il perdu par le Père Noël. La route d’Emily finira par croiser celle de Neil Nyman, au terme de péripéties désopilantes.
Après avoir été capturés par le Père Noël, Neil et Emily se rendent compte qu’ils ont l’obligation de sauver la planète. Le Père Noël, ressuscité de ses cendres, s’est installé dans une base soviétique désaffectée et il médite un Noël littéralement atomique pour se rattraper après huit ans d’absence. Raconter par le menu les incidents qui se succèdent, décrire les personnages incongrus qui ne font que passer, tenter d’analyser le charme sardonique de l’histoire, tout cela est rigoureusement inutile.
Non sans rappeler le collage postmoderniste de Snowcrash de Neal Stephenson, The Claus Effect est aux antipodes de l’ennui et du sérieux qui caractérisent de trop nombreux romans de SF canadienne. à condition d’avoir le sens de l’humour idoine, on se délectera de presque chaque page, à la fois pour la prose hyper-caféinée des deux auteurs, pour leur sens de l’invention et pour leur amour du rebondissement décapant.
La fin, plutôt abrupte, est un peu décevante, mais c’est la seule fausse note – et elle est presque inaudible – de ce merveilleux petit roman. Inutile de dire que je le recommande hautement.
David Morse
The Iron Bridge
New York, Harcourt Brace, 1997, 439 pp.
Le thème du voyage dans le temps n’est pas nouveau et bien des romans ont décrit des tentatives d’infléchir le cours de l’histoire en intervenant dans le passé. L’enjeu de la mission de Maggie Foster, qui part du vingt-et-unième siècle pour retourner au dix-huitième, est pourtant original. Elle vient d’un futur – le nôtre? – où la dévastation de l’environnement et l’épuisement des ressources ont condamné la race humaine à l’extinction prochaine. Elle cherche donc à atténuer l’impact néfaste de la Révolution industrielle – à défaut de l’étouffer dans l’oeuf.
Pour ce faire, elle a accepté de s’exiler en 1773, en Angleterre, afin de saboter le pont en fer sur la rivière Severn. Ce premier pont métallique n’est-il pas à l’origine du gigantisme industriel et architectural, des monuments élevés à la technique, bref des pires excès de l’ère industrielle?
Mais elle n’avait pas prévu à quel point elle devrait se mêler intimement de la vie des constructeurs, les Darby. L’auteur agence avec art une histoire qui est à la fois celle des machinations de Maggie, celle des tensions déchirant la famille Darby et celle de John Wilkinson, le rival des Darby.
Avec une verve qui peut aller jusqu’au comique, le roman plonge le lecteur jusqu’au cou dans cette lointaine époque grâce à l’accumulation de détails concrets. Certains portraits psychologiques sont un peu flous, mais d’autres sont criants de vérité. Au bout du compte, l’auteur réussit à nous surprendre en livrant une fin ambiguë mais entièrement satisfaisante, ce qu’il n’est pas donné à tout le monde de réaliser.
Don DeBrandt
Steeldriver
New York, Ace, 1998, 330 pp.
à l’instar de Spider Robinson, cet auteur canadien de la Colombie-Britannique semble déterminé à émuler Robert A. Heinlein. On retrouve dans ce roman fort divertissant la même camaraderie virile, les mêmes amours maladroites et la même ambiance décalquée du mythique Far West que chez Heinlein. Toutefois, sur la planète Pellay, la reconstitution du Far West américain est délibérément artificielle; elle ne vise qu’à tromper les touristes.
Ce qui s’éloigne un peu de l’héritage d’Heinlein, c’est l’accent qui est mis sur le combat entre une compagnie multimondiale et ses employés, entre le désir de pouvoir de l’une et le désir de liberté des autres. Sur Pellay, la multimondiale Kadai a chargé ses ouvriers de creuser un tunnel d’un bout à l’autre d’une montagne imposante. L’oppression des ouvriers est incarnée par le cyborg Jon Hundred, tueur programmé autrefois au service d’une multimondiale, qui se cache maintenant sous l’identité d’un contremaître. Mais les autres personnages principaux – l’IA Melody, le cyber-assassin Hone, l’actrice Nancy et même le traître Whiskey Joe – sont aussi des pions manipulés par la multimondiale.
Inutile d’accuser DeBrandt de forcer le trait ou de ne pas signer une intrigue très subtile. Les ficelles sont grosses, un personnage secondaire comme Paul Seaborne n’est de toute évidence qu’une utilité et l’humour est parfois assez gras. Cependant, on finit par céder au charme des exploits de tous ces hommes forts, évoquant les histoires légendaires de Jos Montferrand et Paul Bunyan. Dopés par une technologie plus ou moins convaincante, Jon Hundred et ses adversaires finissent par s’affronter de façon spectaculaire. Mais le dénouement n’est pas dicté par les armes, aussi fantastiques soient-elles, mais par des choix humains. Et c’est ce qui garantit que le sourire sur le visage du lecteur, une fois le livre refermé, sera authentique.
Damien Broderick
The White Abacus
New York, Avon, 1997, 342 pp.
Broderick est un auteur australien qui signe ici un ouvrage délibérément postmoderne. Dans sa postface, Broderick avoue d’ailleurs qu’il s’agit très consciemment d’un collage d’images empruntées. L’emprunt majeur est tiré du corpus shakespearien: l’essentiel de l’intrigue s’inspire de la pièce Hamlet .
Le tout se passe dans un futur lointain. Sur la Terre cohabitent des humains anarchistes et des IA, qui ont accès en continu à la circulation des données. Dans la ceinture des astéroïdes, une civilisation plus ancienne a opté plutôt pour l’exploration spatiale et les transformations génétiques.
Telmah, prince d’un astéro de, est envoyé sur Terre pour s’instruire. L’IA baptisée Ratio devient son ami et ils retourneront ensemble dans la patrie de Telmah lorsque le père de celui-ci meurt mystérieusement. Or, l’oncle de Telmah a épousé sa mère et il a pris le pouvoir… Avouons que le simple placage d’une histoire de science-fiction sur la trame de Hamlet est parfois plus ennuyeux qu’autre chose.
Heureusement, la résolution de l’intrigue n’est pas entièrement calquée sur celle de la pièce de Shakespeare. Hollywood est passé par là… Malgré de nombreux emprunts et hommages, le roman se laisse lire avec un certain plaisir. Le futur imaginé par Broderick est fascinant en soi, même si l’histoire n’est que moyennement intéressante.
Solaris 127
Gaston Compère, dir.
Coup de plumes: Bruxelles Fantastique
Bruxelles, Didier Devillez éditeur, 1997, 190 pp.
Ce recueil réunit les dix meilleurs textes d’un concours d’écriture organisé en Belgique en 1997, sur le thème imposé de "Bruxelles-Fantastique". Sous la direction de Gaston Compère, le jury a donc sélectionné plusieurs nouvelles qui relèvent du fantastique ou de l’insolite.
En premier lieu, on retrouve un excellent texte de Christo Datso, "Dualité". Un ancien marinier regrette le temps disparu jusqu’au jour où il voit reparaître des péniches dans le port de Bruxelles; quand il descend au bord de l’eau, il se retrouve dans l’Afrique mythique de son ami Ahmed et choisit d’embarquer sur une des felouques/péniches qui s’en vont. Dédoublement, départ rêvé, mort métaphorique… l’idée est d’une pérennité inusable, mais elle est traitée ici avec subtilité et un style très juste.
Le second texte est déjà moins intéressant. "Quand le chat est parti…" de Philippe Deltenre raconte le curieux face-à-face d’un nouveau locataire et d’un chat errant absolument increvable. Du coup, on verse plutôt dans le fantastique horrifique, un peu grand-guignolesque, mais c’est efficace.
Les deux nouvelles suivantes, "Tant que l’archange veillera" de Bernard Drion et "Brocsella… Fatum" de Valérie Dureuil, voyagent beaucoup dans Bruxelles. Chez Drion, le malaise créé par l’histoire d’une ancienne malédiction reste à l’état d’ébauche, en dépit d’une dernière phrase frappante. Dureuil tente d’accumuler trop d’incidents en trop peu de pages, mais ses idées chatouillent l’imagination; peut-être qu’il y aurait eu là matière à un roman.
Les jeunes Didier Galand et Didier Geirnaert signent des variations sur le thème de l’objet ou du lieu maudit – respectivement une horloge et une librairie. Dans un cas, le descendant échappe à la malédiction qui a frappé l’a eul; dans l’autre cas, non.
Avec "Enterrement de première classe…" de Jean-Louis Godet, on glisse vers la science-fiction. Les cimetières, derniers espaces verts de Bruxelles, sont colonisés par les citadins, qui s’y construisent des pavillons tandis qu’ils relèguent les morts dans les appartements exigus des immeubles abandonnés. C’est la nouvelle la plus amusante du recueil, et peut-être la plus réussie.
Le texte "En quel lieu je suis" de Bertrand Menard rappelle certaines nouvelles québécoises d’il y a quinze ans, quand les écrivains avaient décidé de ne plus raconter d’histoires. Que de mots, que de mots… Didier Thunus signe ensuite un récit de fantastique discret, insolite jusqu’à la paranoïa. Pourtant, l’histoire de "M. et Mme Van Cauwelaert" n’est pas dénuée d’un certain humour absurde, quoique la fin tombe un peu à plat.
Quant à la dernière nouvelle, "Le Conseil de Monsieur Victor" de Lorraine Tison, elle aurait sans doute passé pour sexiste si un homme l’avait écrite. L’irruption d’un fantôme dans la vie d’une mère de famille qui s’ennuie en ménage ne fournit à celle-ci que tangentiellement le moyen de raviver l’intérêt de son mari pour leur relation.
Bref, c’est un recueil de bonne tenue, où quelques textes se démarquent, tandis que l’ensemble se situe dans l’honnête moyenne.
Denis Guiot, Alain Laurie, Stéphane Nicot
Dictionnaire de la science-fiction
Paris, Hachette, Livre de Poche jeunesse, 1998, 283 pp.
L’ouvrage se présente comme une introduction détaillée à la science-fiction pour les néophytes à partir de 13-15 ans. En tout, 66 notices et des appendices fournis définissent les mots-clés (uchronie, utopie, cyberpunk), abordent les ramifications du genre (bande dessinée, cinéma, jeu de rôles, télévision), font le tour des thèmes (clonage, extraterrestres, immortalité, ordinateurs, réalité virtuelle, univers parallèles) et brossent des portraits rapides d’auteurs majeurs (Asimov, Clarke, Dick, Herbert, Jeury, Verne). L’ensemble est d’un très haut niveau et fort complet, eu égard à l’approche très franco-française des auteurs. Ses pages sont agrémentées d’illustrations de Manchu, toujours efficaces et parfois rigolotes, dans un style BD assez classique.
Mis à part quelques coquilles (dont une barre oblique manquante dans l’adresse de Solaris sur la Toile mondiale), le texte échappe en grande partie à la critique. On relèvera quelques généralisations abusives, dues aux partis pris des auteurs (ainsi, il est prétendu que les conventions mondiales sont beaucoup plus américanocentriques qu’elles le sont réellement). Ces mêmes illères franco-françaises sont sans doute responsables de quelques lacunes flagrantes, à mon avis: l’absence de Heinlein parmi les auteurs obtenant une entrée particulière, l’absence d’une notice sur les femmes ou le féminisme dans la science-fiction (ce qui permet d’occulter complètement Russ et Tiptree) et l’omission du Tyranaël de Vonarburg dans la notice sur les livres-univers.
L’orientation des choix de lecture reflète souvent la stature ou la disponibilité d’un écrivain en France même. Elle ne correspondra pas nécessairement à la vision du genre que peuvent avoir les lecteurs canadiens, qui souvent y accèdent aussi par le biais de l’anglais, dans les librairies ou à la télévision. Bref, quoique fort bon, ce livre me semble devoir être surtout recommandé aux lecteurs français.
Néanmoins, comme lexique abrégé de la science-fiction, c’est un ouvrage qui a son utilité et qui est supérieur aux tentatives précédentes des éditeurs français. Il comporte aussi des listes de lectures et de collections spécialisées, qui présentent également le désavantage de se référer uniquement aux livres édités en France. Pour les lecteurs d’ici, c’est donc une référence incomplète, certes précieuse, mais qui ne fournit qu’un début de piste. Hautement recommandé pour les lecteurs français, moyennement recommandé pour les acheteurs canadiens.
Jean-Jacques Nguyen
Les Visages de Mars
Le Plessis-Brion, Orion, 1998, 174 pp.
Pour tous les amateurs de science-fiction et de fantastique moderne, voici un recueil à ne pas manquer. Avec en prime une préface de Lehman, un entretien avec l’auteur et une somptueuse couverture signée Jeam Tag, tout ce qu’on lui peut reprocher, c’est l’ordonnancement des textes par Gilles Dumay.
En effet, sur les quatre premiers textes, trois sont carrément les moins réussis du recueil. Ces premières nouvelles versent dans le fantastique et trahissent l’influence de Lovecraft sur l’auteur, mais ce ne sont pas ses meilleures. Par contre, "Incidents de villégiature" relève d’une approche moins éculée et joue sur le véritable doute fantastique, laissant le lecteur partagé entre l’hypothèse de la folie du protagoniste et la possibilité d’un basculement du monde hors du réel…
Avec "Temps mort, morte saison", on aborde la seconde partie du recueil, de loin la meilleure. Cette nouvelle parue dans Destination Crépuscule 1 est un petit bijou d’émotion et de fantastique inexpliqué. Une histoire d’amour et de mort, merveilleusement ambiguë et finement ciselée. Les cinq derniers textes s’inscrivent de plus en plus franchement dans le genre de la science-fiction. Parfois, la science-fiction ne fournit qu’un décor et un prétexte, comme dans "L’ultime réalité". Parfois, elle ne fournit qu’une amorce d’explication, plus ou moins convaincante, comme dans "L’homme singulier".
à chaque fois, cependant, l’histoire est prenante, de mieux en mieux construite, de plus en plus riche. Les deux dernières nouvelles, "Les Architectes du rêve" et "Les Visages de Mars&