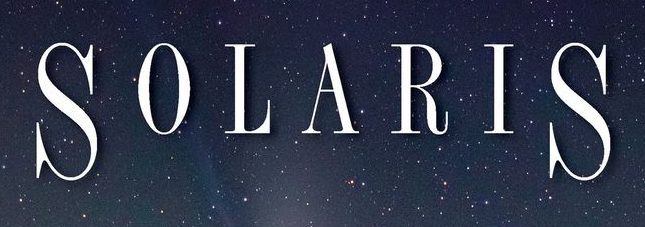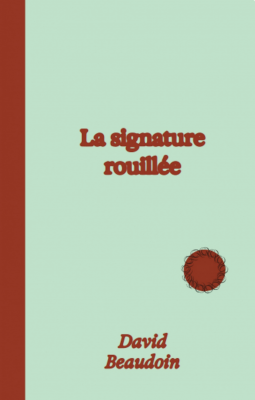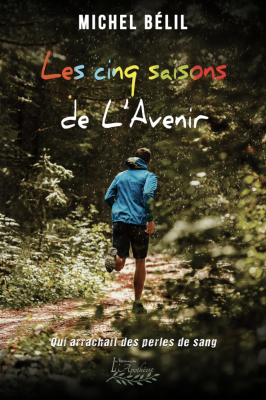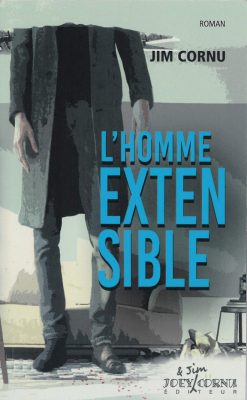David Beaudoin, La Signature rouillée (Fa)
David Beaudoin La Signature rouillée Montréal, Annika Parance (Coûte que coûte), 2022, 154 p. Musée Carnavalet, Paris. Un homme vêtu d’une robe de marié appose sa signature à l’encre noire sur la toile Le sauvetage des malades de l’Ancienne Charité, effaçant du même coup celle de l’artiste, un peintre méconnu du nom d’A. Bélanger. Pour réparer…