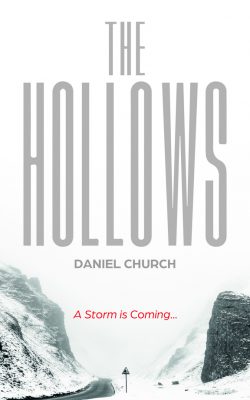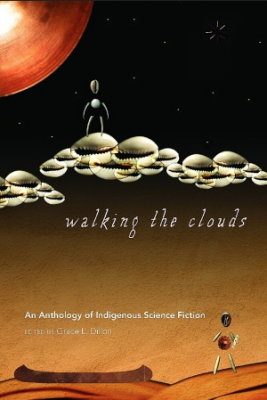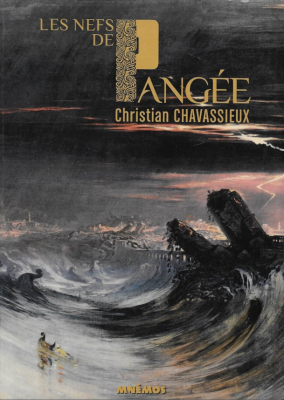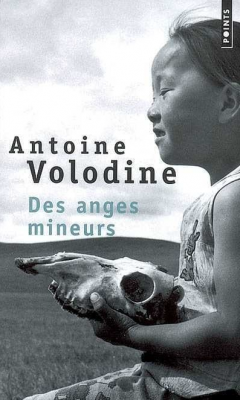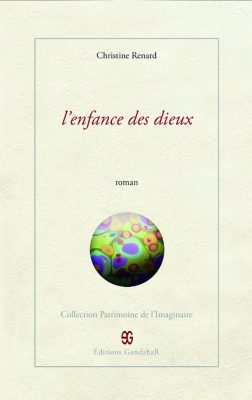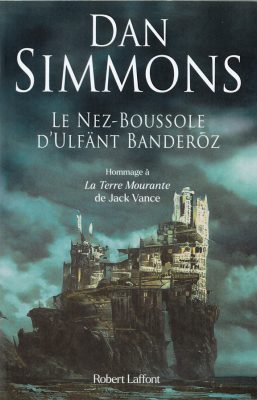Nicholas SERRUYS — L’amplification de voix hurlantes québécoises en France : le cas du groupe de musique métal Beyond Creation
En perpétuelle évolution depuis une cinquantaine d’années et issu progressivement des quatre coins de la Terre, le métal ose transgresser les limites de la musique populaire sur les plans sonore et conceptuel. La langue dominante des chansons étant globalement l’anglais, très peu de groupes de métal dont les membres sont francophones finissent par s’exprimer en…