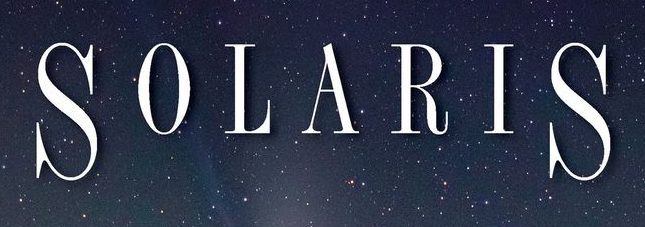Lectures 1997
1997: Solaris 121-124
Solaris 121
Ben Bova
Mars
New York, Bantam Spectra, 1992, 502 pp.
Solaris a déjà recensé les autres romans "martiens" à paraître depuis le début des années 1990, soit Moving Mars de Greg Bear et la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson. Il restait donc à parler de celui-ci. Bova propose une vision beaucoup plus traditionnelle de la découverte de Mars, dans le cadre d’une vision science-fictive tout aussi traditionnelle. On ne retrouvera pas dans ce livre de nanotechnologie, de super-science, de personnages surdimensionnés et surtout pas le souffle de l’épopée qui passe dans les ouvrages de Bear et Robinson. Le cadre politique est déjà démodé, puisqu’on y retrouve encore une Union soviétique, le cadre scientifique s’attache à rester vraisemblable et il s’agit d’un futur très proche, au début du vingt-et-unième siècle.
C’est l’histoire de la première expédition sur Mars, une expédition internationale sous l’égide des états-Unis, du Japon et de l’Union soviétique. Les machinations politiques en coulisse, parfois simplistes, et les interactions humaines un peu compassées évoquent une science-fiction plus ancienne, plus près d’Arthur C. Clarke que de Robinson – même si le personnage principal, Jamie Waterman, de sang Navajo, invoque la figure du Coyote, du "Jongleur", tirée de la mythologie amérindienne, qui apparaît également dans la trilogie martienne.
Bova enfile les péripéties avec l’assurance d’un écrivain de métier, les imprévus d’une exploration à cent millions de kilomètres de la Terre se combinant aux découvertes inattendues. La tension monte peu à peu, à la faveur entre autres d’un mystère médical habilement préparé. Les amateurs d’une science-fiction traditionnelle, qui est plus soucieuse de l’exactitude scientifique que de l’intérêt psychologique, sauront apprécier ce roman et rêver à la découverte de la planète Mars telle qu’elle est…
Lois McMaster Bujold
Cetaganda
Riverdale, Baen, 1996, 302 pp.
Depuis peu, les romans consacrés par Bujold à Miles Vorkosigan semblent alterner les aventures échevelées, toujours divertissantes, et les romans plus sérieux. Cetaganda s’inscrit dans sa veine plus légère, qui multiplie les quiproquos, incidents cocasses et rebondissements divers constituant les ficelles toujours neuves du romanesque.
Les lecteurs retrouveront un Miles Vorkosigan tout jeune, envoyé en compagnie de son cousin au coeur de l’empire de Cetaganda à l’occasion des funérailles solennelles de l’impératrice douairière des ennemis jurés du monde de Miles. Une simple visite diplomatique d’une dizaine de jours… Mais les complications ne tarderont pas à surgir, s’accumuler et proliférer jusqu’à ce que Miles entreprenne de résoudre un mystère et de sauver l’empire pour les (très) beaux yeux d’une aristocrate de… Cetaganda. Le style alerte, souvent sardonique, de Bujold convient parfaitement à la narration de ces intrigues multiples. Et la haute société de Cetaganda n’est pas qu’une énième copie des aristocraties décadentes ou raffinées dépeintes dans tant d’ouvrages: Bujold glisse des motifs authentiquement science-fictifs dans sa création du monde de Cetaganda et le résultat est stimulant, à défaut d’être renversant.
Miles se tirera d’affaire, mais l’imbroglio ne sera pas sans conséquence pour sa future carrière. Bujold laisse entrevoir que les destins de Miles et de l’empire de Cetaganda sont désormais liés et pour longtemps…
Neal Stephenson
The Diamond Age
New York, Bantam Spectra, 1996, 499 pp.
Après avoir exploré l’avenir de la virtualité dans Snow Crash, Stephenson s’intéresse à l’avenir de la nanotechnologie. L’âge du diamant, c’est un monde dominé par les nanomachines en carbone pur, dont les structures fondamentales s’apparentent soit à celle du diamant soit à celle de la buckminsterfullerène (ou de ses dérivés, comme les tubullènes). Le tout donne un roman plus sérieux, plus songé que Snow Crash, mais peut-être un tout petit peu moins réussi. Privé de ses aspects satirique et humoristique, l’univers de Stephenson boitille un peu par endroits, grevé de légères incohérences scientifiques, et la seconde moitié du roman ne peut éviter certaines longueurs.
Néanmoins, il s’agit d’une oeuvre d’envergure, sous les traits d’un roman ostensiblement victorien. Parmi les personnages principaux, on retrouve l’ambitieux ingénieur Percival Hackworth et la jeune Nell. L’action se déplace entre une enclave néo-victorienne et la région de Shanghai, tout en visitant quelques autres lieux à la surface de la planète. Les états-nations ont perdu de leur importance, cédant le pas à des cultures fragmentées, dont celle qui a fondé un retour à la morale victorienne sur la fortune engendrée par la mise au point de la nanotechnologie.
Pour optimiser l’éducation de la jeune fille d’un de ses supérieurs, l’ingénieur néo-victorien Hackworth mettra au point un livre interactif dont plusieurs copies aboutiront en des mains inattendues, comme celles de Nell, fille d’un délinquant exécuté par la justice de Shanghai. L’histoire de l’ascension sociale de Nell et des aventures de Hackworth se mêle aux machinations de plusieurs factions, qui préparent de nouvelles transformations du monde. Et si la première partie du livre illustre les vertus de la pensée victorienne et du triomphalisme technologique, la seconde partie remet en question la supériorité technologique tout autant que le néo-colonialisme des cultures cosmopolites installées à Shanghai…
Çà et là, c’est un roman qui confine au chef-d’oeuvre par ses thèses, par son imagination débridée, par son souci du détail dans l’extrapolation, par ses discours juxtaposés offrant à la fois une vision victorienne du futur et des gens ainsi qu’une critique de cette même vision. Dickens n’est pas très loin, mais J. G. Ballard non plus: certaines scènes évoquent Empire of the Sun, le roman de ce dernier. Stephenson révise en passant la métaphore du virus qui lui avait déjà servi dans Snow Crash, n’ajoutant pas grand-chose à l’intrigue. Le tout se termine sur une variation intéressante des retrouvailles de l’héritière perdue et de sa mère, thème connu à l’époque victorienne… Mais c’est surtout le monde créé par Stephenson qui restera dans les mémoires.
Solaris 123
Tim Powers
Expiration Date
New York, Tor, 1996, 534 pp.
D’un Dante l’autre, d’un fantôme paternel à un autre, d’un univers magique à un autre… Le nouveau roman de Tim Powers commence par la fugue du jeune Kootie qui brise un buste de Dante et découvre à l’intérieur le fantôme de Thomas Alva Edison. Ce geste malheureux plonge le garçon de onze ans dans un monde fantastique où les spectres se repèrent à la boussole, les morts peuvent se survivre et les fantômes se mangent. à la fuite éperdue dans Los Angeles de Kootie, qui transporte désormais l’âme d’Edison, se greffe l’histoire de Pete Sullivan. Ce dernier a collaboré avec sa soeur jumelle à la chasse aux fantômes d’une réalisatrice de films mineurs jusqu’au jour où celle-ci a essayé d’invoquer le spectre de leur père pour le consommer.
Powers tisse une trame ambitieuse où des fils disparates se nouent et s’assemblent, tandis que l’intérêt de la narration est entretenu au moyen de chasses-poursuites haletantes. Des éléments en apparence hétérogènes finissent par composer une fresque cohérente, même si le résultat reste quand même hétéroclite. Le roman souffre de la tension entre les scènes baroques et la surcharge d’incidents nécessaires pour les justifier et les fondre dans un tout convaincant. à la limite, l’auteur trahit son ambition d’intégrer toutes les idées qui lui étaient venues en cours d’écriture et le lecteur aura parfois l’impression de se frayer un chemin au travers de congères de remplissage.
à force de ménager ses effets de suspense, l’auteur laisse l’action prendre le pas sur la réflexion. Par conséquent, la relation de Pete Sullivan avec son père demeure schématique et nettement moins riche que celle dépeinte dans Resurrection Man. Néanmoins, les scènes culminantes à bord du paquebot Queen Mary terminent de façon grandiose un roman fantastique d’un souffle exceptionnel, où Los Angeles fournit des décors immanquablement horrifiques. Bref, il s’agit d’un roman palpitant, mais son indéniable puissance d’évocation souffre de la trop abondante accumulation d’images frappantes.
Solaris 124
C. J. Cherryh
Inheritor
New York, DAW Books, 1997, 460 pp.
Peu d’auteurs réussissent aussi bien que Cherryh à offrir aux lecteurs l’expérience d’une immersion totale dans une culture différente. Dans ce troisième livre de la saga amorcée avec Foreigner, la culture étrangère des atevi non-humains est désormais presque familière à Bren Cameron, l’ambassadeur des humains installés sur le monde des atevi. Cette fois, il doit apprendre à composer avec un compagnon humain, revenu à bord d’un astronef parti depuis longtemps, et avec les errances politiques des siens, sur leur le à l’écart du continent principal.
La minutie des analyses politiques et personnelles confère à l’intrigue une épaisseur qu’elle n’aurait peut-être pas autrement. La situation toujours un peu faussée des deux émissaires humains isolés parmi les atevi permet à Cherryh d’entretenir la tension jusqu’au dernier moment. Comme les deux premiers volumes de cette série qui n’a pas l’air d’être sur le point de s’achever, Inheritor est captivant de bout en bout, et relance l’intérêt en prévision peut-être d’une suite…
Sean Stewart
Resurrection Man
New York, Ace, 1995, 248 pp.
Est-ce un mouvement d’humeur qui m’a fait trouver ce roman insupportable? Le style prétentieux et le romantisme exacerbé de la narration sont peut-être moins agaçants en fin de compte que la propension typiquement américaine à juger d’une vie en termes de réussite ou d’échec, de gains et de pertes… Et en optant pour une fin douce-amère, où l’élément fantastique permet de prendre une revanche sur la mort, l’auteur sabote l’image la plus intense du livre, celle-là même qui, selon l’auteur, avait inspiré l’écriture de Resurrection Man, soit celle du protagoniste en train d’effectuer l’autopsie de son propre corps…
Pourtant, il s’agit d’un roman ambitieux, qui décrit un monde parallèle où la magie a refait surface après la Seconde Guerre mondiale. Le protagoniste est un ange qui a refoulé ses talents magiques et qui a grandi dans une famille de simples mortels, sous la tutelle d’un père sceptique. Il s’appelle Dante (d’ailleurs, l’auteur ne rate pas une allusion) et il a pour talent celui de ressusciter les choses enfouies, les choses mortes, les choses oubliées… Après avoir procédé à sa propre autopsie, Dante se lance à l’assaut de son petit monde dans l’espoir de tout arranger avant qu’il soit trop tard. Malgré tout le talent de l’auteur, malgré des images frappantes, malgré une prose maniée avec un brio étourdissant, le propos finit par para tre mince. Bref, c’est un roman qu’apprécieront surtout les amateurs d’images saisissantes et d’émotions si familières qu’elles confinent au cliché.
Stephen Baxter
Anti-Ice
New York, HarperPrism, 1993, 289 pp.
Dans ce roman, Baxter exploite un filon uchronique dans la veine du steampunk, en postulant la découverte d’un gisement d’anti-glace qui permet à l’Angleterre du dix-neuvième siècle de multiplier le rendement de ses machines à vapeur. (Le plus curieux, c’est que Baxter imagine l’arrivée de cette source d’antimatière gelée sous la forme d’une météorite, mais qu’il semble ignorer la discussion par certains savants de cette même possibilité en faisant appel à une justification différente pour défendre l’existence d’antimatière stable. Ces conjectures avaient inspiré en partie l’écriture de mon roman Pour des soleils froids et sa publication durant la même période…) Le résultat, c’est une Angleterre en mesure de réaliser certains des rêves technologiques de Jules Verne; l’auteur s’ingénie à multiplier les décors qui jouent à la fois sur la nostalgie d’une certaine Angleterre victorienne et la nostalgie d’une certaine science-fiction pré-Campbellienne.
Sans cette charge de nostalgie, le roman s’écroulerait sous le poids de la naïveté des personnages. Certes, leur innocence permet à l’auteur de nous replonger dans l’ambiance de l’époque, mais elle est tellement exagérée qu’elle vire à la caricature. L’optimisme exubérant est loin d’être un trait aussi vernien qu’on le prétend et l’optimisme de Verne n’était pas fondé sur un quelconque aveuglement face aux horreurs de son temps, tout au contraire. Bref, quand Baxter nous prêche les dangers d’appliquer des forces élémentales à la destruction, il paraît simpliste et son allégorie finale de l’équilibre de la terreur nucléaire, avec cinquante ans d’avance, semble curieusement venue, quatre ans après la chute du mur de Berlin…
Finalement, c’est un roman intraduisible, marqué par l’emploi d’un style suranné et l’empreinte d’un chauvinisme britannique (au deuxième degré) qui ne peut que nous amener à rendre grâce pour la rétrogradation du Royaume-Uni au rang des puissances secondaires comme, tiens, la France… Cependant, l’entrain juvénile de Baxter, son imagination disciplinée et son didactisme limpide en facilitent la lecture. Ceux qui seront sensibles à la nostalgie véhiculée par ce livre ne risquent pas de s’ennuyer.
Paul J. McAuley
Fairyland
New York, AvoNova, 1997, 405 pp.
Ceux qui s’intéressent à la science-fiction la plus sérieuse, à celle qui se penche avec lucidité sur les possibilités de notre futur proche et qui ambitionne quand même de façonner une uvre véritablement littéraire trouveront exactement ce qu’ils cherchent en lisant Fairyland. Ce roman, le lauréat du prix britannique Arthur C. Clarke, est un des plus stimulants à surgir depuis longtemps. Je pourrais citer Diamond Age de Stephenson, malgré ses défauts, ou Stations of the Tide de Swanwick, mais j’ai surtout songé aux premiers romans de Gibson en entamant Fairyland.
Le souffle narratif de McAuley, son imagination détaillée et l’envergure de ses conjectures méritent l’admiration. Les personnages sont décrits de l’extérieur, ou ne pénètrent pas toujours leurs propres motivations, ce qui leur évite de verser dans la caricature simpliste et réductrice. L’auteur démontre d’ailleurs un art consommé en faisant progresser l’action des trois principales parties du livre.
Au début, Alex Sharkey n’est qu’un banal concepteur de virus psychoactifs à Londres, pris en tenaille entre la police et la pègre locale qui exige de lui la fabrication des hormones qui permettraient aux "poupées" (des esclaves biologiques aux ancêtres simiens) de se reproduire. Mais il rencontre Milena, qui veut libérer les "poupées" en plus de leur permettre de se reproduire. Quelques années plus tard, de nombreuses "poupées" sont devenues des "fées" évadées qui vivent en marge de la société et vénèrent Milena, qui a plongé dans la clandestinité. Dans les ruines d’un parc d’amusement en lisière de Paris, Alex réussit presque à retrouver Milena dont il veut saboter les visées encore nébuleuses. Dans le dernier tiers du livre, une petite guerre oppose des "fées" sauvages et des mercenaires aux confins de l’Albanie et de la Grèce pendant que Milena prépare son invasion de l’informonde et qu’Alex cherche à empêcher les survivants d’une secte manipulée par Milena de propager leurs infovirus…
à chaque étape, les enjeux gagnent en importance et l’action gagne en intensité ou en envergure. Ainsi, si l’intrigue para t démarrer lentement, elle ne fait qu’accélérer jusqu’à la conclusion du livre. Jusqu’à la fin, McAuley soutient notre intérêt en proposant des concepts audacieux, pas toujours neufs ou entièrement logiques, mais immanquablement plausibles, lui permettant de composer le portrait cohérent d’une Europe transformée par une nouvelle révolution technologique. Le seul reproche qu’on pourrait faire, c’est d’anticiper sur les effets des percées nécessaires en génétique et en nanotechnologique. L’histoire démontre que les grandes inventions, comme la machine à vapeur, le générateur électrique ou l’ordinateur, mettent plusieurs décennies à réaliser leur potentiel en métamorphosant le monde. Nonobstant cette compression de l’évolution technologique, Fairyland demeure un roman de science-fiction comme on aimerait en lire plus souvent. Hautement recommandé.
James Alan Gardner
Expendable
New York, Avon Books, 1997, 337 pp.
à l’instar du roman Starplex de Robert J. Sawyer, cet ouvrage raconte une aventure spatiale bien menée, qui renouvelle un genre dominé par les poncifs de Star Trek, mais sans transcender les forces et les faiblesses des schémas classiques.
Festina Ramos est une exploratrice, recrutée comme ses collègues en raison d’une difformité qui empêche le commun des mortels de s’apitoyer sur le sacrifice souvent nécessaire de ces explorateurs. Le concept est paradoxal, hardi, mais pas entièrement convaincant. Néanmoins, le récit ne souffre d’aucun temps mort, surtout que Gardner agrémente d’une charmante pointe d’humour ses nombreuses péripéties. L’équipée de Festina sur la planète Melaquin où on l’a abandonnée est palpitante et riche en rebondissements. Bref, si la minceur des bases du roman n’agace pas le lecteur, celui-ci sera diverti de bout en bout sans jamais risquer de s’ennuyer.
N. Lee Wood
Faraday‘s Orphans
New York, Ace Books, 1997, 294 pp.
Ce second roman de l’auteure qui avait signé Looking for the Mahdi laisse tomber l’attendrissement qui perçait parfois dans son premier livre. Wood opte cette fois pour une intensité soutenue et implacable de l’action.
Le roman commence en 2242, alors que la Terre a subi deux siècles plus tôt l’inversion du champ géomagnétique que nous promettent pour bientôt les spécialistes. Le bombardement radioactif de la planète désormais sans défense a éliminé toute vie non-protégée. Quelques communautés survivent sous des dômes, dont celui de Pittsburgh, aux états-Unis. à l’extérieur de ces dômes, c’est le règne de la barbarie, mais il faut quand même assurer la liaison entre les survivants, tâche dont se chargent les pilotes de quelques avions rafistolés.
Berkeley Nielsen est le pilote de l’unique hélicoptère encore en état de fonctionner. En 2242, lors d’une mission d’exploration, il perd son appareil et il échoue dans les ruines de Philadelphie. Rallier la civilisation sera suprêmement éprouvant, mais il découvrira en même temps que la civilisation dont il est l’enfant n’offre pas la liberté dont il aimerait faire bénéficier la jeune fille qui l’a sauvé des sauvages de Philadelphie…
Cette Sadonya est une mutante dont le talent est infiniment plus crédible que ce qu’on trouve d’habitude dans ce genre de roman (y compris dans le récent Wonderland de Serge Lehman). Les aventures de Nielsen et de Sadonya sont brutales et violentes, et pour ces raisons mêmes fort prenantes, mais la reconstruction de la civilisation est un objectif classique et presque obligé dans les scénarios post-apocalyptiques. En fin de compte, ce roman ambitieux, et qui a les moyens de ses ambitions, n’est peut-être pas aussi intéressant qu’il pourrait l’être parce qu’il n’offre qu’une variation sur un thème qui n’est certainement pas neuf.
Serge Lehman
Tonnerre lointain
Paris, Fleuve Noir, 1997, 236 pp.
Curieusement, c’est peut-être un roman qui se lirait plus facilement s’il n’était pas le troisième volume dans la série "F.A.U.S.T." lancée par Lehman au Fleuve Noir. Les deux premiers tomes nous avaient habitués à des suspenses haletants dans des décors futuristes soignés. Cependant, au lieu de nous offrir la suite des démêlés du jeune Chan Coray avec l’Instance, l’auteur raconte l’histoire d’une quête qui mènera Coray d’un bout à l’autre de l’Eurasie et qui l’amènera à revivre une partie de sa vie. En quittant le Village des privilégiés, Coray replonge dans le Veld des exclus. La piste presque immatérielle de celle qu’il essaie de rejoindre l’entra ne dans un voyage dantesque, à travers les guerres et les fiefs des nouveaux tribalismes, en passant par les forteresses des grandes compagnies de l’Instance.
L’odyssée tour à tour brutale, mélancolique, tragiquement ironique et toujours un peu folle de Coray se conclut sur une série de surprises, en partie préfigurées par un prologue merveilleusement adroit. Dans un tel cadre, l’amour est nécessairement une chose fuyante, à la fois devant et derrière lui, mais le jeu de masques auquel prend part Coray ne fournit pas toutes les réponses aux questions que Coray ne se pose pas – mais qui hanteront le lecteur.
Bref, c’est un roman de science-fiction francophone nettement supérieur à la moyenne, mais qui est moins une aventure dominée par l’action qu’une découverte d’un monde futur par les yeux d’un surhomme blessé…
David G. Hartwell, anth.
Year‘s Best SF 2
New-York, Tor, 1997, 441 pp.
On se souviendra de cette anthologie des meilleurs textes de 1996 pour avoir été la première anthologie anglophone du genre à inclure une nouvelle par un auteur canadien d’expression française, soit Yves Meynard, dont le texte "Tobacco Words" a été retenu par Hartwell. (Les lecteurs de Solaris auront découvert la version française sous le titre "Les mots du tabac".)
Cependant, l’anthologie en soi est plutôt inégale. Des textes d’un intérêt relatif, telles les nouvelles de Sheila Finch, Kathleen Ann Goonan ou Kate Wilhem, côtoient des textes mineurs dont l’importance est plus historique qu’intrinsèque, telles les nouvelles de John Brunner ou Joanna Russ. Certes, il n’y a pas de textes médiocres, mais certaines nouvelles sont avant tout amusantes, comme "In the Upper Room" de Terry Bisson, "After a Lean Winter" de Dave Wolverton ou "Nonstop to Portales" de Connie Willis. D’autres nouvelles regorgent de qualités littéraires et témoignent d’une perception lucide de la nature humaine, sans toutefois exciter notre sens de l’émerveillement, comme "The House of Mourning" de Brian Stableford ou "Red Sonja and Lessingham in Dreamland" de Gwyneth Jones.
à en croire Hartwell, c’était l’année des hommages. Le meilleur de l’anthologie, c’est celui de Dave Langford, "The Spear of the Sun", qui rend hommage à la fois à G. K. Chesterton et à la SF classique dans la meilleure tradition asimovienne, et de façon fort désopilante.
Les textes marquants sont notables par leur variété. Cela va de la spéculation politico-judiciaire dans "Doblin’s Lecture" d’Allen Steele à l’immersion virtuelle dans les flux économiques pratiquée par les protagonistes de "Zoomers", de Gregory Benford. James Patrick Kelly signe une nouvelle à la fois perspicace et prenante sur la vie dans l’espace, "Breakaway, Backdown", qui donne en quelque sorte la réplique à "It’s Great to be Back!" de Heinlein. "Life Edit" de Damon Knight est un texte de SF métaphysique qui est peut-être le plus percutant du recueil. La nouvelle "First Tuesday" de Robert Reed est de l’anticipation politique, et sans doute l’antidote qu’il fallait au texte de Steele.
Enfin, au nombre des meilleurs textes, on retrouve certainement "Counting Cats in Zanzibar" de Gene Wolfe, toujours aussi dense et savoureux, surtout quand il renouvelle un thème qu’on aurait pu croire usé, et "Bicycle Repairman" de Bruce Sterling, qui offre une fois de plus une vision décapante du futur proche. La nouvelle finale de l’anthologie est tout aussi mémorable dans son genre. On pourrait classer "Columbiad" de Stephen Baxter parmi les hommages, mais il s’agit avant tout d’une allégorie. Pour qui sait la lire avec ce sens très britannique de l’ironie de Baxter et pour qui regrette comme lui les espoirs évanouis de l’exploration spatiale, il s’agit en fait d’un des textes les plus authentiquement tragiques de l’anthologie.
Bref, Hartwell tire un portrait de famille de la SF publiée en anglais en 1996. S’il ne plaira pas à tout le monde, il aura au moins le mérite de refléter l’indéniable variété des textes de l’année.
William Gibson
Idoru
New York, Berkley, 1997, 383 pp.
Un jour, on lira les romans les plus récents de Gibson pour se faire une idée de l’époque actuelle, tout comme on peut lire aujourd’hui les polars de Chandler et Hammett afin d’en apprendre un peu plus sur leur époque. Virtual Light et Idoru appartiennent au même univers, au même avenir à peine dissemblable du présent, quoique les personnages d’Idoru ne soient pas ceux qui figuraient dans Virtual Light, à une exception près.
Gibson nous promène dans un futur qui est un reflet déformé de notre monde, même si l’ALéNA a déterminé de nouveaux ensembles politiques, même si la virtualité est le nouveau lieu de rencontre des ados, même si les idoles de la jeunesse sont des logiciels autonomes et même si Tokyo a subi un séisme dévastateur…
Lo et Rez sont deux célébrités planétaires, les inventeurs d’un son fusion dont la popularité ne s’est pas démentie depuis son apparition. Or, Rez, célibataire le plus convoité du globe, a annoncé qu’il veut convoler avec une idoru, une idole virtuelle présente sur les réseaux japonais. La nouvelle incite la jeune Chia, une groupie de Seattle, à s’envoler vers Tokyo pour plaider avec Rez au nom de toutes ses admiratrices pré-pubères d’Amérique du Nord. La même nouvelle incite Blackwell, l’influent garde du corps de Rez, à embaucher Laney, un analyste gestalt de l’univers des données informatiques. Laney, qui a survécu à une enfance pénible, quitte avec soulagement le marché nord-américain où il est brûlé – sans se douter que son passé le rattrapera, même au Japon.
Une sous-intrigue impliquant Chia dans une dangereuse affaire de nanotechnologie prohibée attendue par la Mafiya russe achève de pimenter l’histoire. La somme de ces intrigues n’a pas nécessairement la densité et l’impact des deux premiers romans cyberpunk de Gibson, mais Idoru s’inscrit plutôt dans la lignée de Mona Lisa Overdrive et Virtual Light, des ouvrages où la narration prend le pas sur la science-fiction proprement dite.
à condition de ne pas en exiger ce qui faisait toute la force fiévreuse de Neuromancer ou Count Zero, la lecture d’Idoru constituera une plongée dans un monde exotique et offrira un kaléidoscope d’idées neuves. Gibson échafaude son histoire plus lentement qu’autrefois, mais il sait encore conserver l’intérêt du lecteur jusqu’à la fin.
Don Bassingthwaite et Nancy Kilpatrick
As One Dead
Clarkston, White Wolf Publishing, 1996, 412 pp.
Dans ce livre, deux auteurs canadiens qui n’en sont pas à leurs premières armes dans le genre de l’horreur combinent leurs talents. Le cadre du roman est un jeu de rôle de la même compagnie qui en assure la publication. à l’intérieur des contraintes intrinsèques liées au jeu en question, Bassingthwaite et Kilpatrick se tirent honorablement d’affaire.
Bassingthwaite apporte à l’ouvrage sa connaissance approfondie des quartiers les plus animés de Toronto, déjà manifeste dans son roman antérieur Pomegranates Full and Fine, tandis que Kilpatrick l’enrichit de sa sensibilité à la fois littéraire et romantique. Le résultat, c’est une histoire de vampires modernes à Toronto, bourrée de scènes percutantes, de luttes pour le pouvoir et de trahisons.
Ensemble, les deux auteurs signent un roman où l’action faiblit rarement, et qui n’est pas dénué de quelques scènes qui transcendent nettement les limites du genre. Les lecteurs que ne rebuteront point l’étalage de violence sanguinaire et les scènes de torture devraient l’apprécier sans réserve à condition de ne pas exiger autre chose que ce qu’il offre.
Lois McMaster Bujold
Memory
Riverdale, Baen, 1996, 462 pp.
Après Cetaganda, une aventure beaucoup moins éprouvante pour son protagoniste, Miles Vorkosigan, l’auteure amorce dans Memory un virage majeur dans la carrière de Miles. Après sa mort physique dans Mirror Dance, Miles doit survivre à sa mort professionnelle. Il s’agit peut-être bien du roman le plus intense écrit par Bujold, qui soumet Miles à un bouleversement complet de sa vie. Avec son talent habituel, elle rend prenante une histoire qui aurait pu être pénible et elle livre un roman somme toute palpitant.
Renouant avec les portraits approfondis de la société de Barrayar qu’elle avait signés dans Barrayar et Mirror Dance, Bujold tente de donner plus d’épaisseur à ce qui peut toujours appara tre comme un avatar science-fictif des principautés d’opérette du type illustré par Zenda. Le mariage anticipé de l’empereur et le nouveau rôle de Miles servent de prétextes à cette exploration plus fouillée, qui s’intègre parfaitement à l’action.
Ironiquement, c’est l’attentat perpétré contre Simon Ilyan, patron des services secrets impériaux, qui permet à Miles de s’en sortir. Les répercussions de son congédiement avaient révélé les ressorts profonds de l’homme, sa première défaite nous en apprenant plus sur Miles que toutes ses victoires antérieures… Afin d’identifier le coupable de cet attentat, Miles retrouvera son élan habituel et percera une énigme qui, curieusement, ne semblera pas si obscure que cela pour les lecteurs aguerris.
Du coup, si Miles a retrouvé tout son allant, la suite de ses aventures devient fort mystérieuse. Les prochains romans de Bujold exploiteront-ils son passé de mercenaire interstellaire? Ou bien se tourneront-ils vers son futur sur Barrayar (et ailleurs) aux ordres directs de l’empereur?
Julie E. Czerneda
A Thousand Words for Stranger
New York, DAW Books, 1997, 366 pp.
Cette nouvelle auteure canadienne rejoint les rangs de Robert J. Sawyer, James Alan Gardner et des autres écrivains en train de réinventer le space-