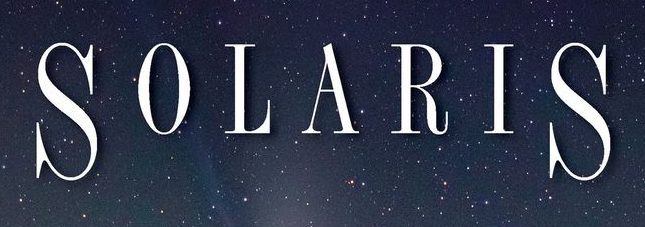Lectures 1996
1996: Solaris 117-120
Solaris 118
Robert J. Sawyer
The Terminal Experiment
New-York, HarperCollins, 1995, 333 pp.
Il s’agit du meilleur roman de Sawyer que j’ai lu à ce jour. Toutes les forces de Sawyer – imagination technologique, rigueur logique, personnages crédibles et intéressants – s’y retrouvent et très peu de ses faiblesses. C’est l’histoire de Peter Hobson, qui travaille sur des interféromètres quantiques capables de détecter l’activité bio-électrique du cerveau. Ce faisant, il découvre en auscultant la cervelle des mourants une onde rémanente qui ressemble fort à la conception traditionnelle de l’âme et qui l’amène à s’interroger sur la vie après la mort. Or, la science de 2011 est sur le point de permettre aux humains d’acquérir l’immortalité. Pour savoir s’il vaut mieux opter pour l’immortalité ou pour la survie de l’âme après la mort du corps, Hobson duplique son esprit trois fois sous forme électronique. Deux de ces intelligences artificielles sont modifiées afin de connaître l’équivalent de l’immortalité physique et l’équivalent de l’immortalité spirituelle. Mais l’expérience vire au désastre quand Hobson s’aperçoit que l’une des trois intelligences artificielles télécommande des assassinats pour se débarrasser de personnes qu’elle – en fait, Hobson – n’aime pas.
Toutefois, l’intrigue policière n’est que moyennement prenante et c’est surtout sur le plan de la science-fiction que The Terminal Experiment vaut le détour. Sawyer maîtrise bien la technologie du futur proche et ses personnages sont décrits sans concession. Le personnage de Hobson n’est pas infaillible, n’est pas sans reproche, mais il demeure sympathique. Surtout, Sawyer réussit dans ce livre à intégrer harmonieusement la problématique scientifique et la vie personnelle d’un scientifique vieillissant. Le résultat est un roman de science-fiction qui porte à la réflexion. Recommandé.
Laurent Genefort
L’homme qui n’existait plus
Paris, Fleuve Noir Anticipation # 1974, 1996, 187 pp.
Une fois de plus, Genefort démontre qu’il est parfaitement à l’aise dans le cadre du Fleuve Noir Anticipation. D’ailleurs, ses trois ou quatre derniers romans maintiennent un niveau de professionnalisme qui est fort rare chez les écrivains de science-fiction en France. Genefort avait toujours maîtrisé la création d’univers fictifs réalistes et colorés, mais il a enfin trouvé le moyen de leur adjoindre des intrigues valables, ce qui était loin d’être le cas dans Rézo ou Arago. Certes, il s’agit de romans moins ambitieux, mais ceux-ci lui permettent d’explorer à chaque fois de nouvelles facettes de son talent.
L’homme qui n’existait plus, c’est Bela Hicks (et Hicks, c’est X, bien sûr), pris au piège d’une station spatiale abandonnée. Mais il n’a pas été oublié par accident, c’est la volonté de Katz – dont seule la voix se fait entendre grâce aux haut-parleurs omniprésents – qui a isolé Hicks, un gestionnaire dans la trentaine, à bord de la station désaffectée. Un jeu du chat et de la souris s’engage donc entre Hicks et le mystérieux Katz, qui a interposé des sections dépressurisées entre lui et les quartiers habités, et qui a saboté tout ce qui pourrait aider Hicks à s’échapper.
Mais Katz ne peut pas contrôler entièrement l’existence de Bela Hicks, qui tente de s’évader, apprivoise un rat, se penche sur son passé, essaie de s’évader encore et encore, tente de deviner l’identité de Katz… En effet, il ne restait qu’une femme et sept autres hommes lorsque Hicks avait perdu connaissance au moment où il allait rentrer chez lui. Katz est forcément une de ces huit personnes. Cependant, le jeu un peu gratuit de l’identification du coupable ne captera pas vraiment l’intérêt des lecteurs; quelques indices laissent deviner l’identité de Katz, mais sa motivation ne pourra être éclairée que par d’ultimes révélations.
En fait, ce n’est décidément pas cette énigme qui retiendra l’attention des lecteurs, mais plutôt le récit des aventures de Bela Hicks, qui fait l’apprentissage de la solitude absolue, et la description d’une station spatiale complexe en orbite autour d’une planète semblable à la lune Titan, mais en beaucoup plus gros. Au bout du compte, l’histoire n’est pas nécessairement plus conséquente qu’une aventure de Jean-Pierre Garen, mais du moins les lecteurs n’auront jamais l’impression en lisant du Genefort que l’auteur les prend pour des crétins…
Solaris 119
Michelle Sagara
Lady of Mercy
New-York, Del Rey, 1993, 339 pp.
Chains of Darkness, Chains of Light
New-York, Del Rey, 1994, 373 pp.
Ces deux derniers livres de la tétralogie "The Sundered", par l’auteure torontoise Michelle Sagara, déçoivent un peu. Les conventions du fantastique épique traditionnel, superbement dédaignées par Sagara dans les premiers volumes, opèrent un retour en force qui réduit l’intérêt de la narration. Les deux premiers tomes avaient raconté l’histoire d’Erin, guerrière du Coeur brillant qui est capturée par Stefanos, le Premier Serviteur du Coeur sombre. Chacun d’eux a hérité de sa part du sang divin, mais la magie brillante s’oppose inéluctablement à la magie sombre. Pourtant, entre ces deux ennemis na t un amour fragile, nourri des obstacles immenses qui les séparent. Dans les deux premiers livres, Sagara avait confiné le gros de l’action à un seul lieu et elle n’avait pas multiplié inutilement le nombre de protagonistes.
Toutefois, dans ces deux derniers tomes, Erin entreprend une quête en deux temps pour abolir le pouvoir du Coeur sombre et du vaste empire qui lui est associé. Dans Lady of Mercy, elle s’entoure de la petite bande d’aventuriers, de coquins sympathiques et d’alliés mystérieux qui sont inévitablement de mise dans tous les mauvais romans de fantastique épique depuis Tolkien. Partis pour libérer la toute dernière contrée tombée sous la coupe du Coeur sombre, ils connaissent en chemin les péripéties habituelles: embûches, rixes de tavernes, trahisons, retrouvailles inopinées.
Le dernier volume, Chains of Darkness, Chains of Light, est la répétition du troisième, sauf que l’enjeu est différent et que la confrontation finale est plus dramatique. Toutefois, la rédemption par l’amour dont se sert Sagara pour sceller le sort du Coeur sombre m’a paru conclure la quête d’Erin de façon moins intéressante que le revirement de Frodo au sommet d’Orodruin, le refus de désespérer de Thomas Covenant ou le sacrifice librement consenti de Paksenarrion, pour ne citer que quelques-unes des grandes épopées fantastiques des dernières décennies.
Quoi qu’il en soit, il s’agit de deux romans palpitants qui exigent d’être lus jusqu’à la dernière page. Les personnages sont attachants et la description fouillée qu’en fait Sagara leur permet d’échapper aux pires clichés. Ces deux derniers livres ne réserveront pas vraiment de surprises aux lecteurs aguerris, mais ils ne risquent pas non plus de les ennuyer outre-mesure.
Don Bassingthwaite
Pomegranates Full and Fine
Clarkston, White Wolf Publishing, 1995, 443 pp.
Chaque fin de siècle a les satanistes et vampiristes qu’elle mérite. Le dix-neuvième siècle a eu droit au Là-bas d’Huysmans et au Dracula de Bram Stoker. Le vingtième siècle a droit à des versions presque caricaturales de ces mêmes mythes, transformés en phénomènes de masse et contes à faire peur. Dans Pomegranates Full and Fine, on peut dire sans trop exagérer que c’est presque tout le folklore occidental qui est accommodé à la sauce industrielle. Reprenant les motifs de la fantasy urbaine telle que pratiquée par Charles de Lint et Emma Bull, l’auteur torontois Don Bassingthwaite réunit dans Pomegranates Full and Fine les vampires, les magiciens, les créatures féeriques, les démons, les pouvoirs parapsychologiques – il y a même une allusion aux loups-garous – et les rues de Toronto. Cependant, il ne faut pas reprocher à Bassingthwaite l’hétéroclite de ce cadre, car celui-ci repose en grande partie sur l’univers fictif mis au point par la compagnie de jeux de rôles White Wolf.
Donc, comme Edo van Belkom, un autre auteur torontois qui écrit pour cette compagnie, Bassingthwaite se doit de respecter des règles édictées par autrui. Il le fait en démontrant un talent certain, car il met en place une intrigue complexe dont les tenants et aboutissants seront peu à peu démontés par Tango – appelons-la une farfadet – et la vampire Miranda travaillant de concert. Croyant s’attaquer à une secte sataniste, elles découvriront que même les créatures de l’ombre peuvent se tromper sur la nature de leurs ennemis.
Trois éléments retiendront surtout l’attention dans ce roman voué à l’action. D’abord, il y a le monde occulte décrit par Bassingthwaite, où vampires, magiciens et créatures féeriques vivent en marge de la société, attachés à des illusions et des chimères qui leur permettent de supporter des existences parfois misérables ou peu glorieuses; par moments, j’ai eu l’impression que Bassingthwaite parlait du fandom. Ensuite, il y a la ville de Toronto qui sert d’arrière-plan aux aventures de Tango et Miranda; démonstrations devant Queen’s Park, chaleurs suffocantes de la mi-juillet, mélange de courtoisie et de froideur des citadins, tout y est rendu avec une plume sensible aux moindres nuances de la vie urbaine. Enfin, il y a la relation entre Tango et Miranda; leur amitié forgée dans l’action devra surmonter la méfiance et la nature sanguinaire de ces deux êtres.
Un peu moins humain que le Wyrm Wolf d’Edo van Belkom, ce roman intéressera néanmoins les amateurs de fantasy urbaine en terre canadienne.
Eileen Kernaghan
Dance of the Snow Dragon
Saskatoon, Thistledown Press, 1995, 325 pp.
Eileen Kernaghan est une auteure canadienne précédemment connue pour ses romans mêlant le fantastique épique, des reconstitutions historiques et la culture celtique. Cette fois, elle a voyagé beaucoup plus loin, car ce roman transporte le lecteur sur le Toit du Monde. Encore une fois, elle mélange le fantastique épique à une culture, une contrée et une histoire appartenant au monde que nous connaissons. Il s’agit de la culture bouddhiste, entre le plateau tibétain et les contreforts des Himalayas, à une époque reculée qui se confond avec la légende.
C’est l’histoire d’un jeune montagnard choisi pour devenir moine bouddhiste dans une lamasserie au Bhutan, au dix-huitième siècle. Mais la vocation chancelante de Sangay Tenzing l’incite à entreprendre une périlleuse quête au-delà des montagnes, pour atteindre le royaume de Shambhala. En chemin, il rencontre une voyageuse, Jatsang, aux pouvoirs magiques et elle l’aidera à traverser les montagnes pendant qu’il fera son apprentissage de la ma trise de soi. Loin du cadre historique du Bhutan, le pays de Shambhala est un pays magique qui évoque le décor des anciens contes hindous.
En fin de compte, Sangay deviendra le sauveur de Shambhala et découvrira qu’il est la réincarnation d’un héros légendaire. La conclusion du roman n’est pas sans rappeler certains motifs de L’Espace du diamant d’Esther Rochon, qui a également été influencé par les mythes bouddhiste. Une analyse plus serrée découvrirait sans doute de nombreux parallèles.
Il s’agit d’un roman initiatique, qui retrace le parcours de Sangay depuis son enfance jusqu’au seuil de la maturité. Ostensiblement, il n’est pas destiné aux jeunes, mais c’est pourtant l’impression qu’il donne. Cela n’empêchera pas les lecteurs plus âgés de goûter les aventures fantastiques de Sangay et Jatsang dans les plus hautes montagnes du monde…
Marian Hughes
Initiation
Riverdale, Baen, 1995, 378 pp.
Les auteurs de science-fiction ne sont pas légion au Canada, du moins ceux qui ne tirent pas tôt ou tard de leur chapeau un passe-droit aux lois connues de la physique ou de la biologie pour se dépêtrer des contradictions de leur fiction. C’est pourquoi il faut saluer le fait que Marian Hughes, dans son premier roman, ne commet pas d’infraction scientifique flagrante.
Certes, le cadre du roman est favorable à un strict respect des lois de la Nature, car la société qu’elle décrit est limitée à une technologie primitive. Ces naufragés sur une planète hostile (air connu…) survivent grâce à la chasse et à la cueillette. Marian Hughes renouvelle cette situation classique en introduisant le motif du "berserker", de l’homme ou de la femme dont les forces sont décuplées par une rage hystérique; sur cette planète, une partie des humains qui ont survécu à l’écrasement de l’astronef subissent la transformation en "berserkers" lors de la puberté. L’intrigue s’attache aux actions de deux adolescents à ce moment critique de leur vie. Le jeune Bart, fils de chasseur, s’attend à devenir "berserker" afin de faire partie de l’élite des chasseurs. La jeune Sanda redoute cette transformation, car les femmes qui la subissent sont bourrées de drogues tranquillisantes qui les rendent dociles tout en les abêtissant. Les deux jeunes gens seront pourtant obligés de composer quand la réalité ne correspond pas à leurs désirs. Ce faisant, ils découvriront certains des secrets de la transformation en "berserker", contribueront à changer un peu leur société et se donneront des raisons d’espérer.
Le rythme soutenu de la narration et la description de personnages auxquels les lecteurs peuvent aisément s’identifier facilitent la lecture du livre. Toutefois, Marian Hughes dépeint l’évolution de personnages adolescents et tout le roman se ressent de ce choix. En fin de compte, il s’agit d’un excellent roman pour les lecteurs de cet âge, dans la lignée des romans pour jeunes comme Tunnel in the Sky de Robert A. Heinlein ou Dragonsinger d’Anne McCaffrey, mais qui ne déplaira pas non plus aux adultes.
Maureen F. McHugh
Half the Day Is Night
New York, Tor, 1996, 375 pp.
Le premier roman de McHugh, China Mountain Zhang, avait été justement encensé, mais ce second livre laisse perplexe. Certes, il est palpitant et bien construit, partagé entre deux protagonistes crédibles, Jean David Dai et Mayla Ling, et il se déroule dans un cadre à la fois futuriste et plausible. Cependant, il se laisse lire d’une façon trop transparente comme un renvoi aux réalités d’aujourd’hui pour constituer un roman de science-fiction entièrement satisfaisant. Dans China Mountain Zhang, l’altérité du monde décrit en faisait plus qu’un simple décor. à défaut d’être entièrement plausible, le futur de China Mountain Zhang avait l’avantage d’être autonome.
Par contre, dans ce livre, tous les éléments de l’intrigue renvoient plus ou moins nettement au monde que nous connaissons ou à des mondes que nous avons connus. Même le pays sous-marin de Caribe, pourtant décrit avec beaucoup de conviction, semble artificiel, uniquement conçu afin de compliquer la vie des protagonistes qui tentent de s’en échapper. McHugh insiste tellement sur tous les processus qui accaparent le précieux oxygène de l’air – que ce soit les moteurs à explosions ou les grils au charbon – qu’on se demande pourquoi une société qui a besoin d’une atmosphère respirable serait à ce point laxiste, si ce n’est que pour accentuer les parallèles entre Caribe et certains pays en voie de développement du monde actuel. En passant, il faut noter que McHugh met dans la bouche de ses personnages des passages en français et en espagnol pour donner à son oeuvre un exotisme de bon aloi, mais ces brèves citations sont émaillées de nombreuses erreurs, témoignant d’une typographie bâclée ou d’un travail de rédaction incomplet.
Half the Day Is Night est clairement une histoire de guerre, ce qui ne veut pas dire que c’est de la SF militaire. Jean David Dai, vétéran des guerres africaines, croit trouver à Caribe un havre de paix auprès de son employeuse, la banquière Mayla Ling. Mais Ling, mêlée à des manoeuvres financières qui la dépassent, devient aussi la cible des mouvements terroristes ultra-religieux de l’archipel sous-marin. Entre la dictature de Bustamante, et sa police politique, et le règne des corporations, et leurs Tontons (macoutes?), Mayla Ling est prise en étau. Cédant à la panique, elle entre dans la clandestinité, rejoint Dai et décide de fuir son pays.
C’est donc une nouvelle mouture de l’éternel roman des réfugiés et apatrides enfantés par les guerres du vingtième siècle. Les échos historiques – Juifs du Troisième Reich, dissidents de l’Union Soviétique, démocrates au Chili, à Haïti ou en Argentine, Bosniaques de l’ex-Yougoslavie – sont multiples et tendent à réduire le roman à une allégorie composite. Dai et Ling réussiront à obtenir les papiers qui leur permettront de partir, mais la tension des ultimes moments du livre fera oublier aux lecteurs que le havre de liberté et de paix vers lequel se dirigent Dai et Ling, ce sont les états-Unis d’Amérique…
P. K. McAllister
The Cloudships of Orion: Maia‘s Veil
New Yor, Penguin/ROC, 1995, 287 pp.
Avec cet ouvrage, Paula King McAllister livre le second volet d’une trilogie fascinante, "The Cloudships of Orion". Comme dans le premier volume, Siduri’s Net, l’astronomie joue un rôle essentiel, car Siduri’s Net est un astronef conçu pour exploiter les queues de comète, les vents stellaires et les nébuleuses afin d’en retirer des éléments indispensables au maintien d’une civilisation interstellaire. Dans le premier livre, Siduri’s Net avait fait le saut jusqu’à l’étoile naissante T Tauri et plongé dans le geyser de gaz surchauffés qui jaillit de l’embryon stellaire. Ceci devait régler l’imbroglio politico-financier qui paralysait l’activité habituelle de l’astronef dans son système d’attache. Dans cette entreprise, Pov Janusz, jeune homme d’origine gitane, avait brillé par son esprit d’initiative, alors même qu’il était en butte aux pires difficultés avec sa famille, et surtout sa mère, une traditionaliste inflexible l’accusant de trahir la culture gitane.
Dans ce livre-ci, l’équipage de Siduri’s Net découvre que la fortune en isotopes rares qu’il rapporte de T Tauri ne suffit pas à régler ses problèmes. Les conflits d’allégeance qui avaient rendu la situation si complexe dans le premier livre se règlent peu à peu, car les périls extérieurs au vaisseau forgent une nouvelle solidarité.
Pour échapper à la mainmise de politiciens avides, Siduri’s Net doit fuir jusqu’aux Pléiades, mais cet amas galactique est la chasse gardée d’une poignée d’astronefs qui répugnent à accueillir un rival potentiel. Siduri’s Net devra faire ses preuves avant d’enrôler les autres astronefs pour une entreprise audacieuse: un saut jusqu’à la nébuleuse d’Orion…
Pendant ce temps, Pov Janusz a acquis le respect de ses supérieurs et participe activement à l’aventure de Siduri’s Net dans un nouveau territoire. Cependant, sa liaison avec une femme qui n’est pas gitane le conduit au bord de la rupture avec sa mère, mais la crise entra ne en fin de compte une réconciliation partielle des membres de la famille Janusz. McAllister décrit un personnage complexe, conscient des côtés désuets de sa culture, mais assez sage pour trouver encore un sens aux rituels gitans. Ainsi, en plus du panorama astronomique dépeint avec un art consommé, c’est aussi toute la problématique de l’harmonisation de la modernité et de la tradition qui donne à cette trilogie son intérêt, en attendant le troisième volet.
Hugues Douriaux
Interférences
Paris, Fleuve Noir Anticipation # 1975, 1996, 186 pp.
Il s’agit de la suite d’un roman de fantastique épique intitulé Les Sortilèges de Maïn, où la jeune Jennifer avait dû affronter le démon Arquohost dans une autre réalité. Dans Interférences, Jennifer est un peu plus vieille et cette adolescente de la France contemporaine se retrouvera mêlée à des événements déroutants, à des milliers de kilomètres de sa banlieue parisienne.
En effet, une conjonction inexplication rassemblera au même point de l’espace-temps des protagonistes de trois époques différentes. D’une part, il y aura Jennifer et la sorcière française Marie. D’autre part, il y aura Johnny Landon et son amie Lisa, deux Apaches de 1970. Et puis, il y aura aussi toute la faune du Far West au dix-neuvième siècle: soldats de la cavalerie U.S., pionniers blancs et guerriers apaches… dont l’ancêtre du beau Johnny. à la faveur d’un embrouillamini total des époques, Jennifer (quinze ans et demi) tombera amoureuse de Johnny « Grey Bear" Landon – ou peut-être de son a eul, O-na-Ha-Peh – ce qui permettra au démon Arquohost, qui a tout machiné, d’avoir prise sur elle.
Douriaux balade ses lecteurs dans l’Ouest mythique qui séduit tant les Français, mais son portrait assez exact des lieux et des événements reste superficiel. (Il fait naître son lieutenant de cavalerie dans une ville qui n’existait pas encore…) Le démon Arquohost ne semble être qu’un prétexte, dont le sort est réglé en deux temps trois mouvements. Le drame de la conquête des peuples autochtones est esquissé par Douriaux, mais, en fin de compte, on ne peut que se demander si cette tragédie pas si lointaine n’est qu’un autre prétexte devant conférer une touche d’exotisme au dépucelage de Jennifer par un beau guerrier apache…
C. J. Cherryh
Invader
New York, DAW, 1996, 462 pp.
Invader, c’est le deuxième volet d’une trilogie entamée avec Foreigner et qui se terminera avec la publication prochaine d’Inheritor. à la faveur de cette oeuvre majeure, Cherryh poursuit un de ses grands thèmes, le choc des cultures et la communication par-dessus les fossés qui les séparent.
D’une part, il y a les humains dont l’astronef s’est perdu, aboutissant loin de la Terre. D’autre part, il y a les atevi, les indigènes humano des de la planète sur laquelle certains de ces humains vont s’établir tandis que l’astronef repartira, à la recherche d’un espoir bien nébuleux… Les humains apportent une technologie de loin plus développée que celle des atevi, mais ces derniers possèdent un génie arithmétique qui va leur permettre d’assimiler tout ce qu’ils obtiendront des humains. à la suite d’hostilités, un humain – le paidhi – sera désigné pour servir d’unique intermédiaire entre les atevi et les humains.
Quand l’astronef reviendra, deux siècles plus tard, Bren Cameron est le paidhi et il devra affronter la méfiance des atevi, effrayés par l’intrusion d’un astronef d’une puissance inconnue. Il sera effectivement pris en étau entre la méfiance des atevi et la peur de ses congénères, qui se sentent vulnérables face aux atevi et aux humains revenus des étoiles. Cherryh plonge ses lecteurs dans la culture d’une espèce intelligente qui ressemble à l’humanité mais qui lui est pourtant profondément étrangère par la biologie. Si la culture et la langue atevi évoquent par moments celles du Japon féodal, la ressemblance n’est que superficielle, comme le paidhi l’a appris à ses dépens.
Cherryh raconte l’histoire d’un homme qui, lors des événements décrits dans Foreigner, avait reconnu ses faiblesses et son ignorance de la culture atevi. Dans Invader, même s’il est toujours ballotté par les événements, Bren Cameron a bénéficié des leçons qu’il a si durement assimilées. Rassurer la populace atevi, se concilier leurs dirigeants, pénétrer leurs intrigues intestines, échapper aux attentats qui le prennent pour cible… De chacune de ces obligations dépendent son existence et la paix de toute la planète, et il parvient tant bien que mal à sauvegarder les deux.
Peu d’écrivains savent doser aussi bien que Cherryh les alternances de l’action et de l’attente et, surtout, comment transformer les temps morts en suspenses terrifiants. Les dernières pages du livre sont haletantes, mais les questions laissées en suspens à la dernière ligne ne seront résolues que dans le prochain et dernier volume.
Solaris 120
Shariann Lewitt
Memento Mori
New-York, Tor, 1995, 286 pp.
Ce tout dernier livre de l’auteure étatsunienne Shariann Lewitt (précédemment connue sous le nom de S. N. Lewitt) se démarque nettement de ses ouvrages antérieurs, et de plus d’une façon. Certes, la petite coterie de jeunes artistes et idéalistes au coeur du roman rappelle le groupe semblable de la colonie néo-française de Beausoleil décrite dans Blind Justice ou la petite bande évoquée au début de Songs of Chaos. De même, la capitale de la planète de Reis s’inspire des villes cosmopolites de l’ancienne Mitteleuropa, quelque part entre Vienne et Prague, tout comme Blind Justice et Songs of Chaos brossait le portrait d’avatars des sociétés française et brésilienne respectivement.
Cependant, toute l’action de Memento Mori est confinée à la capitale de la colonie néo-allemande de Reis. Suite à l’apparition d’une peste virale, la ville est isolée de son arrière-pays. à l’occasion de cette quarantaine qui s’éternise, les citadins se heurteront à leurs illusions d’autrefois et devront se mesurer à leurs démons. Le spectre de la mort subite rôde, ce qui change toutes les données de la vie ordinaire. à la mort, certains essaieront d’opposer l’Art avec un grand A, tandis que d’autres essaieront de la lui marier. Des joueurs d’échecs découvriront de nouvelles facettes de leur passion, une intelligence artificielle sera infectée par la tentation de se faire humaine et une scientifique tentera de comprendre ce qui leur arrive.
Si la rapidité des morts rappelle Un hussard sur le toit de Giono et les interrogations existentielles La Peste de Camus, l’ambiance de ce roman nous renvoie aussi à notre propre époque à l’optimisme déjà atteint par le SIDA, en attendant Ebola et les filovirus de demain, et par la fatigue des fins de siècle. Si ce roman en déconcertera certains, c’est tout simplement parce que les romans de SF philosophique sont rares de nos jours. C’est en effet à une méditation sur les fondements de la vie – l’art, l’amour, la mort, la douleur, l’adolescence – que nous sommes conviés. Toutefois, l’auteure elle-même n’avouerait peut-être pas ouvertement cette ambition. Le roman n’est-il pas intitulé Memento Mori, portant le nom donné dans les toiles de maître d’autrefois à un crâne, ou un autre symbole morbide, placé au coin d’un étalage comme rappel de notre mortalité et de la vanité des choses humaines?
Poul Anderson
The Stars Are Also Fire
New-York, Tor, 1994, 562 pp.
Après avoir signé presque une élégie d’une certaine SF traditionnelle résolument optimiste et extravertie dans Harvest of Stars, Poul Anderson n’a pu s’empêcher de corriger la part de désespoir tranquille de sa conclusion dans un second livre. Celui-ci constitue moins une suite qu’un roman parallèle, car les événements décrits dans ce livre sont à la fois antérieurs et contemporains de l’action dans Harvest of Stars.
Là où Harvest of Stars laissait entendre que les colons du système d’Alpha Centauri avaient fui un système solaire de plus en plus contrôlé par des intelligences artificielles, The Stars Are Also Fire montre que les humains du système solaire revendiqueront encore et toujours la liberté de découvrir de nouveaux mondes.
Le roman s’intéresse donc aux efforts d’une poignée d’irréductibles, à l’époque des IA triomphantes, pour retrouver un ancien secret… D’autre part, le roman retrace la vie de Dagny Beynac, pionnière de la Lune dont les enfants génétiquement adaptés aux conditions lunaires forment une société seigneuriale de plus en plus autonome et de plus en plus étrangère au reste de l’humanité.
Dans le roman précédent, Anderson avouait presque que les nouveaux horizons de la SF – IA, immortalité des personnalités transférées sur support informatique, transcendance des noosphères informatiques – rendaient en partie caduque la SF d’antan. Mais, dans celui-ci, il signe une aventure qui constitue presque une apologie de cette même SF, plaidant que le destin de l’humanité ne peut pas se borner au simple confort matériel, bref, qu’il faut laisser une chance à la nouveauté et qu’il faut aller voir au-delà de l’horizon parce qu’on ne peut pas prévoir l’imprévu…
Don Bassingthwaite
Breathe Deeply
Clarkston, White Wolf Publishing, 1995, 293 pp.
Ce roman s’inscrit dans le cadre d’un jeu qui est également produit par la compagnie White Wolf. L’auteur doit donc composer avec un univers pré-établi, aux règles déjà fixées. Bassingthwaite relève avec compétence ce qui pourrait être considéré comme un défi.
Dans un monde qui est le nôtre, des loups-garous bienveillants, appelés les Garous, s’opposent aux puissances du mal. De par leur patrimoine surnaturel, ces Garous sont avant tout les défenseurs de la nature sauvage. Ce livre racontera donc un épisode de la lutte qui met aux prises les Garous et une multinationale en train de ravager l’Amazone. Le héros, un Garou originaire de Toronto, connaîtra bien des aventures, sous la plume alerte de ce jeune auteur canadien, avant de mener à bien la double mission dont il a été chargé.
Cet exercice très commercial révèle néanmoins une nouvelle sensibilité à l’oeuvre dans le portrait de ces Garous qui maîtrisent plusieurs métamorphoses et restent sanguinaires tout en combattant pour la bonne cause. Il s’agit de fantasy qui assume pleinement ses racines animistes en faisant de la nature et des bêtes des partenaires beaucoup plus actifs que dans la fantasy traditionnelle. Cette nouvelle esthétique traduit le changement de perspective radical qui a transformé la pensée occidentale au cours des vingt dernières années, atteignant maintenant le niveau de la fiction dans ses fondements les plus mythiques, puisque la divinité tutélaire des Garous est tout simplement Gaia…
David Weber
Flag in Exile
Riverdale, Baen, 1995, 442 pp.
Ce roman est le cinquième livre consacré par David Weber à son héro ne préférée, Honor Harrington. Sous le couvert du space-opéra, il s’agit d’un avatar des romans qui retracent la grande époque des batailles navales de la marine à voile, avec Honor Harrington à la place de Horatio Hornblower. C’est toujours, disons, du bonbon à l’état pur si on