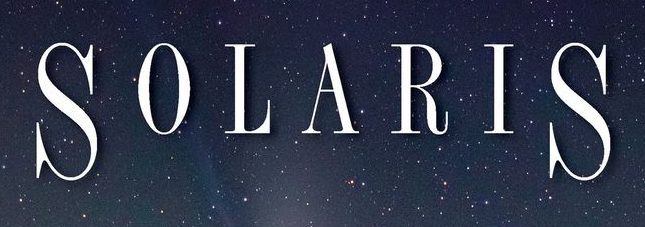Lectures 1994
1994: Solaris 109-112
Solaris 111
Neal Stephenson
Snow Crash
New-York, Bantam, 1993, 470 pp.
C’était le livre dont parlaient tous les jeunes lecteurs branchés de SF américaine, l’année dernière, même si les "vrais fans" ont préféré des livres plus traditionnels pour les Hugos, tels que les romans de Vernor Vinge et Connie Willis. Snow Crash, c’est un roman de la génération X, c’est un roman de la Californie actuelle déguisée en état déglingué de demain, et c’est aussi un roman résolument post-moderne, à ne pas prendre plus au sérieux qu’il ne le faut. Ce n’est pas un hasard si la même para-culture des courriers indépendants se retrouve dans le roman Virtual Light de William Gibson. Jusqu’à preuve du contraire, Gibson est un des écrivains les plus à l’écoute de ce qui se passe à cinq minutes dans l’avenir.
Le héros de Snow Crash s’appelle, comme par hasard, Hiro Protagonist. L’autre protagoniste porte le nom de Y.T., c’est-à-dire Yours Truly, c’est-à-dire que c’est le personnage auquel s’identifie l’auteur – et il s’agit d’une jeune fille qui fait des commissions sur sa super-planche à roulettes. Hiro la rencontre en effectuant une livraison de pizza qui tourne mal. En fait, de fil en aiguille, ils découvrent une vaste conspiration occulte fondée sur un virus d’origine sumérienne qui a des formes biologique et informatique, et qu’un monopoliste de l’information veut propager.
L’ironie est le mode prédominant de la narration. La chef de la Mafia garantit personnellement la livraison en trente minutes de toutes les pizzas de l’Amérique. Les exilés de Hong Kong habitent une série d’enclaves gardées par des chiens robots, énergisés par leurs propres piles nucléaires. Les pauvres de l’Asie envahissent les états-Unis par vagues successives portées par un grand agglomérat de navires appelé le Radeau. Notre héros et son antagoniste se retrouvent pour un duel dans l’informonde et découvrent que leurs pères se sont connus dans des circonstances dramatiques.
L’histoire oscille entre le sérieux et la farce débridée, avant d’opter pour ce style dit "gonzo", si je ne m’abuse, et pratiqué par certains auteurs américains d’il y a trente ans. Ainsi, Stephenson poursuit une narration à la fois classique et outrancière tout en bourrant ses lecteurs de coups de coude pour s’assurer qu’ils ne prennent pas tout ça pour du comptant, tout de même! Et ça marche, car Stephenson excelle dans l’art de se maintenir sur la corde raide entre l’éculé et l’incroyable. Ses personnages ont beau être des créations fictives évidentes, ils se gagnent néanmoins l’adhésion des lecteurs.
L’intrigue réserve de nombreuses surprises et coups de théâtre, parfois gratuits mais toujours surprenants. Le dénouement correspond à un de ces nettoyages meurtriers qu’affectionnent les Américains, mais n’affaiblit pas vraiment le reste du livre. Cependant, un avertissement s’impose: le ton détaché et grinçant de la narration suscitera sans doute des réactions diverses, selon l’âge des lecteurs, car il peut sembler désagréablement maniéré et artificiel.
Yves Ramonet
Les perspectives du mensonge
Paris, Denoël, 1994, 267 pp.
Yves Ramonet aurait pu être le Neal Stephenson français. Il a pour lui une maîtrise stylistique éblouissante, une connaissance indéniable de la technologie moderne et un imaginaire abreuvé aux meilleures sources, des cyberpunks à Sheckley et Pynchon. Cependant, le roman se situe dans la ligne des ouvrages les plus paranoïaques de Philip K. Dick et Michel Jeury, et n’apporte pas grand-chose de neuf à la thématique que ceux-ci ont exploré maintes fois, hormis quelques trouvailles mineures. Il ne suffit pas d’exhiber un imaginaire doté d’un pedigree pour avoir de l’imagination, mais c’est pourtant la qualité que Ramonet tente de mettre en évidence dans ce roman.
Dans un monde totalement câblé, doté de réseaux dont les ramifications électroniques se prolongent à l’intérieur des crânes, les créations des artistes de tous les temps ont acquis une vie virtuelle. La réalité de ces fictions commence à contaminer la réalité du protagoniste, Svevo Miller, qui est pris dans l’engrenage du Komplet Komplot en même temps que Rabid Rabbit, Lucrezia Panciatichi et Rufus Thibeaultd’O, entre autres. La lutte pour l’existence des créatures virtuelles connaît de nombreuses péripéties, sanguinolentes plus souvent qu’autrement, et plusieurs adversaires.
Ce qui manque surtout à Ramonet, c’est probablement l’ampleur nécessaire pour faire de cette succession de caricatures de véritables personnages. Dans Snow Crash, Stephenson brosse des portraits sardoniques de protagonistes qui seraient autant de lieux communs s’il n’y avait pas de petits détails savoureux pour les individualiser. Ramonet ne parvient pas à différencier ses personnages des poncifs du genre, à l’exception de Rabid Rabbit et Rufus Thibeaultd’O, qui sont pourtant des comparses.
Et puis, il y a les détails. La biotechnologie est apprêtée à toutes les sauces au cours du roman, et il manque souvent les explications qui rendraient ces mélanges plus digestes. Toutefois, le véritable mystère, c’est pourquoi l’auteur fait de La Cène de Léonard da Vinci un tableau alors que c’est une fresque. L’erreur semble trop grosse pour en être une, et pourtant…
Néanmoins, s’il s’agit bien de son premier ouvrage de science-fiction, il faut avouer que Ramonet est un talent prometteur. Par moments, la prose est incandescente et ce, dans plusieurs registres différents, allant de la description sanguinolente aux visions psychédéliques et aux recréations romantiques d’un passé révolu. Sa verve est à son meilleur dans les extraits médiatiques dont l’auteur pimente le texte. Il ne reste plus à Ramonet qu’à maîtriser l’art de raconter une histoire!
Jean-Marc Ligny
La mort peut danser
Paris, Denoël, 1994, 328 pp.
Je ne connais pas toute l’oeuvre de Ligny, mais ce livre se démarque agréablement de tout ce que j’ai lu de lui, car c’est nettement le meilleur jusqu’à maintenant. à croire qu’il a été possédé par un barde celtique le temps de l’écrire!
En fait, c’est presque le cas, car le roman est inspiré par le groupe musical irlandais "Dead Can Dance", composé de Lisa Gerrard (qui signe une dédicace) et Brendan Perry. Les chansons et les albums de Dead Can Dance " fournissent les titres de tous les chapitres du livre. Cependant, un avertissement souligne qu’il ne s’agit aucunement d’une biographie romancée du groupe.
L’histoire débute quand Bran Parish et Alyz Gerald reviennent d’Australie pour emménager dans un vieux manoir irlandais dont Alyz a hérité. Des rêves et des visions du passé commencent à hanter Alyz. Lorsqu’ils tentent de relancer leur carrière musicale, Alyz électrise la salle d’un petit bar en chantant avec une voix et dans une langue que Bran ne lui connaissait pas. Sous le nom de La mort peut danser, ils obtiennent sur-le-champ un contrat avec une compagnie d’Edinburgh.
Cependant, il y a maldonne, car la chanteuse, c’est vraiment Forgaill, poétesse et prophétesse irlandaise du douzième siècle, qui revit en Alyz. Dès lors, le roman bifurque, retraçant le destin dramatique de Forgaill qui vit les heures les plus noires de l’invasion anglo-normande de l’Irlande et aussi la confusion qui règne dans la vie d’Alyz et Bran.
Le livre témoigne d’un effort de recherche soutenu lorsqu’il esquisse le portrait de l’Irlande du douzième siècle. Les échos entre chaque époque sont subtils et l’existence d’Alyz est de plus en plus troublée jusqu’à ce qu’elle accepte la pleine réincarnation de Forgaill.
C’est donc un roman de fantasy moderne, dans la lignée de ceux de Charles de Lint et Emma Bull. Le talent de Ligny façonne une histoire envoûtante qui, sans être criante d’originalité, n’a pas un accroc. Tout simplement, c’est le meilleur roman de fantasy écrit en français que j’ai lu jusqu’à aujourd’hui.
Jean-Louis TRUDEL
Mise à jour: Août 2000 –