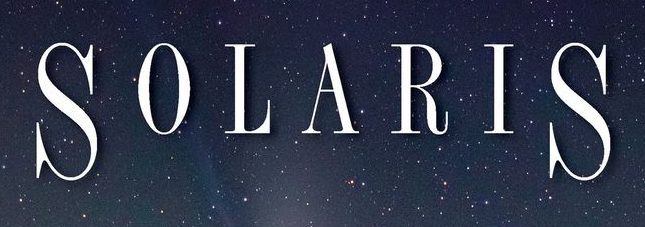Jean Tétreau, Les Nomades (SF)
Jean Tétreau et l’Ève nouvelle
Jean Tétreau est un écrivain qui, sans faire partie du courant de littérature de SF ou fantastique, a écrit néanmoins quelques œuvres d’imagination dans cette veine entre ses essais philosophiques. Il s’intéresse aussi à la sinologie.
Les Nomades est un roman d’anticipation qui débute au moment où un cataclysme naturel ébranle toute la Terre. Ce bouleversement déclenche du même coup le mécanisme de défense qui entoure la planète afin de la protéger contre une invasion possible des habitants d’un autre univers. Ainsi, contre la volonté des hommes, la Terre subit les effets d’une guerre atomique dont les conséquences s’ajoutent au cataclysme naturel. La vie disparaît presque complètement à la surface de la planète. Le paysage est complètement transformé, les villes sont détruites et la végétation, après quelques mois, retrouve une luxuriance et une vitalité jamais égalées. La technologie de la civilisation qui a été ainsi balayée n’existe qu’en mémoire. La vie sur terre en 1990 est revenue à l’époque du Moyen-Âge.
Toutefois, quelques êtres humains ont survécu à ce grand bouleversement en se terrant dans des abris souterrains ou simplement par miracle, comme l’héroïne Sylvana. Celle-ci sommeillait sur la plage quand le cataclysme est survenu. Elle s’est réveillée alors que toute trace de vie avait disparu autour d’elle. C’est ainsi que commence un voyage à travers la désolation, la mort et l’indigence. L’auteur décrit une vision apocalyptique de la Terre : atmosphère grise et imprégnée de cendres, soleil absent, végétation morte, mer calme et écumeuse.
Après plusieurs mois de pérégrinations à travers le pays dévasté, Sylvana rencontre Niels, un Danois avec lequel elle partage son existence. Les périodes de nomadisme et de sédentarité alternent. Sylvana veut retrouver sa mère tandis que Niels veut se joindre à une nouvelle société qui s’organise, parait-il, à Aoste. En effet, petit à petit, la vie renaît, la nature s’adapte aux nouvelles conditions et l’homme tente de mettre sur pied une nouvelle civilisation avec les moyens dont il dispose. Niels mourra d’une chute en montagne mais Sylvana, de retour dans sa patrie d’enfance, donnera naissance au premier enfant du bourg depuis le cataclysme.
Les Nomades est un roman dédié à la ténacité, au courage et au désir de vivre propres à l’être humain. Malgré les pires revers du sort, l’être humain continue d’espérer, de lutter pour la survie de son espèce et d’entretenir une foi inébranlable et indéfectible. L’auteur admire la facilité avec laquelle l’homme s’adapte à son nouvel environnement.
Plus qu’un roman d’aventures et un hymne à la force de caractère de l’homme, Les Nomades est aussi un très beau poème consacré à la vie. Tétreau dépeint la renaissance de la nature dans un style sobre ou abondent les images de plénitude, de joie et d’espérance. Fleurs flamboyantes, nature sauvage, couleurs vives, végétation abondante, tout respire le renouveau, la pureté, l’innocence et la fraîcheur des recommencements. À l’aube d’une vie nouvelle et primitive, l’optimisme et l’espoir des hommes rendent tout possible et convient a une plus grande sagesse. Le roman de Jean Tétreau possède un indéniable pouvoir de régénération et la fin résolument optimiste constitue un tonique merveilleux parce qu’elle couronne un remarquable combat pour la vie.
L’auteur sait également faire passer ses préoccupations philosophiques. Les réflexions concernant la morale, l’organisation d’une société et la procréation ajoutent à la richesse de l’œuvre. Tétreau a su parfaitement agencer dans son récit d’anticipation les éléments inhérents au roman d’aventures, au roman philosophique et au roman d’amour. Cependant, l’idée de situer l’action en Italie ne me semble pas très heureuse. Il aurait été plus facile pour le lecteur de suivre les nombreux déplacements de Sylvana au Québec et les transformations radicales de la croûte terrestre auraient été plus significatives.
Je m’interroge aussi sur la pertinence du deuxième chapitre intitulé « Ténèbres ». Cet épisode de space opera n’apporte rien à la compréhension du récit même si, en soi, il s’avère intéressant et bien construit. Il joue un rôle d’accessoire et de gadget et il rompt l’unité du récit.
À la décharge de l’auteur, il faut reconnaître que cet épisode relatant une tentative de retour sur Terre des êtres en orbite autour de la planète alimente l’analyse de l’homme devant une situation de crise.
Sans que la thèse ne soit jamais développée au détriment de l’aventure, Les Nomades représente un des hommages les plus touchants et les plus chaleureux à la persévérance et au courage humains. C’est un roman qui milite en faveur de la vie et dans lequel on ne trouve aucune trace de naïveté ou de mièvrerie. Si Un été de Jessica a été désigné comme le meilleur roman de SF des années soixante-dix, Les Nomades de Jean Tétreau mériterait, a mon avis, le même titre pour les années soixante.
Jean Tétreau
Les Nomades
Montréal, Éditions du Jour, 1967, 261 p.
Jean Tétreau a aussi écrit un recueil de six nouvelles, Volupté de l’amour et de la mort, que l’éditeur a décrit à tort comme des « histoires fantastiques ». En fait, il n’y a qu’une nouvelle qui soit véritablement un récit fantastique. Elle s’intitule » »Le Décret impérial ». Il y est question d’une toile qui change de motif et qui rend fou son propriétaire par suite de ces mystérieuses métamorphoses. À la limite, « Ni vu ni connu » recèle aussi une somme de fantastique. Cette imposture de la part d’un illusionniste qui s’est fait passer pour le grand Boudini (sic) renferme une charge d’insolite et de mystère.
Claude JANELLE