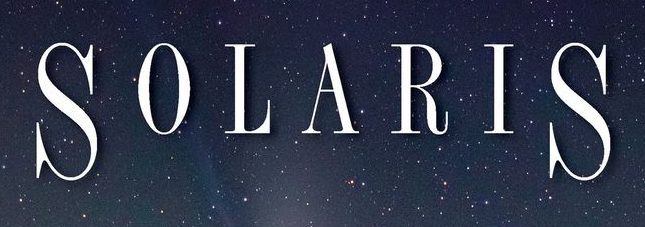Collectif, La Nouvelle Barre du jour n˚ 79-80
La Nouvelle Barre du jour (NBJ), qui est une revue littéraire identifiée aux jeunes écrivains à la recherche de nouvelles écritures, a confié la réalisation d’un numéro double à Roger Des Roches et Louis-Philippe Hébert. Le thème du No. 79-80 de la NBJ est la science-fiction. La présence d’Hébert dans cette revue littéraire n’est pas étonnante. Depuis plusieurs années maintenant, il écrit des récits de science-fiction et de fantastique tout en recherchant un nouveau langage.
La participation de Roger Des Roches est plus inattendue. Ce poète, qui s’est distingué au cours des années soixante-dix par son écriture nouvelle, n’avait jamais manifesté, à ma connaissance, un intérêt pour la science-fiction. C’est en tant qu’amateur de SF que sa présence dans ce numéro a de quoi surprendre.
Signalons tout de suite que le sommaire réunit dix auteurs différents et vingt textes. Outre les deux responsables de cette publication, ont fourni des textes : Jean Brossard (2), Germain-Guy Beauchamp (3), Bertrand Bergeron (2), Johanne de Bellefeullle (1), Hughes Corriveau (1), Élisabeth Vonarburg (1), Jean-Pierre Vidal (1), et Jérôme Elie (2).
Il va de soi que les deux textes d’introduction ne puissent être considérés comme des œuvres de création, encore que celui de Des Roches emprunte les règles de la fiction littéraire. Cependant, il me semble qu’il est déplacé de trouver, entre deux récits de fiction, un « essai » de définition de la SF ou un texte théorique sur l’œuvre de P. K. Dick. Je pense qu’il eut mieux valu s’en tenir aux textes de création ou, a tout le moins, départager les deux genres.
Réglons d’abord le cas des textes théoriques Dans son introduction intitulée « La Fiction-Science », Louis-Philippe Hébert plaide en faveur d’une nouvelle écriture qui soit en adéquation avec le message. Le problème de la SF (ou de la FS) en est un d’anachronisme : il s’agit de décrire une situation du futur avec le langage du présent, ce qui, en soi, est ridicule. « Parce que… « avec les mots de la tribu », la SF préfigure l’avènement d’une nouvelle tribu – tout en étant consciente que « nouvelle tribu » mène inévitablement à nouveau langage. Et comment décrire demain avec les mots d’hier ? » (p. 8). Hébert définit aussi ce qu’il entend par fiction-science. Selon lui, nous sommes en plein renversement de situation « Alors que la science voit de nos jours son caractère absolutiste contesté, la fiction voit ses « prédictions » se réaliser » (p. 8). Bref, la brillante introduction de Hébert nous propose une réflexion pertinente sur le rôle et la définition de la SF.
Pour sa part, Roger Des Roches explique les objectifs de ce numéro, les critères de sélection des textes. « Nous allons donc présenter quelques-unes des directions dans lesquelles la SF s’engage au Québec. Des textes qui essaient, tant bien que mal, de s’intégrer, sans éclat, dans l’ensemble de la SF… » (p. 16). Il le fait sous une forme romanesque, ce qui constitue une façon agréable de présenter les choses et d’entrer tout de suite dans le vif du sujet.
Il ne nous dit pas, cependant, comment ont été recrutés les auteurs qui figurent au sommaire, si cela s’est fait par l’entremise d’amis communs. Car, outre Élisabeth Vonarbourg et Jacques Brossard qui sont connus dans la littérature de SF, de même que Hughes Corriveau qui a écrit un recueil de poèmes et un roman, les cinq autres auteurs me sont tout à fait inconnus. Aucune note biographique n’accompagne la présentation des écrivains, contrairement d’ailleurs au numéro 89 consacré au fantastique.
Le troisième texte théorique s’intitule « L’Effet d’irréel » et est signé Jérôme Elie. Il mêle fiction et théorie en un salmigondis inimaginable. Le texte d’Élie décrit la banalité de la vie quotidienne de W. M., puis il tente d’analyser les romans de l’écrivain californien Philip K. Dick. Il s’agit d’un exercice pénible, ennuyeux, écrit dans un jargon incompréhensible qui ne vise, semble-t-il, qu’à nous rappeler que nous sommes à la NBJ.
Le dernier texte d’analyse est produit par Germain-Guy Beauchamp qui présente lui aussi une définition de la SF : « Signifiant Fantaisie ». Ce faisant, il apporte un point de vue différent de celui de Hébert quand il pose la question suivante : « Est-ce que la SF ne pourrait pas être alors un laboratoire d’idées et de comportements neufs nous préparant à une nouvelle façon de vivre qui tiendrait compte des connaissances acquises sur l’espace-temps ? » (p. 103). Voilà donc une deuxième définition de la SF à laquelle en vient Beauchamp après avoir suivi au cours des décennies l’évolution de ce genre littéraire.
Puisqu’on y est, passons donc aux récits qui composent l’autre volet de ce numéro. Jacques Brossard y publie des extraits d’un roman qui doit s’intituler L’Oiseau de feu. Le premier extrait, plus intéressant que le second, décrit une cérémonie en hommage au Roi de la Cité de Manokhsor, une ville gouvernée par un pouvoir occulte, mystérieux et pénible. Il est difficile de saisir la nature exacte du message véhiculé par le récit puisqu’il s’agit d’un extrait. Toutefois, on devine que l’auteur veut prouver que l’homme n’est encore qu’un primate, évolué certes, mais un primate tout de même. Le Roi que l’assemblée vénère se métamorphose en un singe primitif, à un certain moment donné.
Quoi qu’il en soit, ces deux extraits allument notre intérêt et ils incitent à acheter le roman de Brossard quand il paraîtra. C’est un livre qui est attendu avec impatience.
La nouvelle d’Élisabeth Vonarburg, « L’Or, l’encens et la myrrhe », est découpée en douze tableaux courts qui semblent mener deux intrigues parallèles qui se rejoignent en cours de route. Le récit raconte le désespoir d’un homme qui veut rencontrer un représentant des extraterrestres ayant pris contact avec les Terriens. Félix veut demander aux Koonin si leurs concitoyens connaissent les maux de la Terre, à savoir la guerre, le racisme, la misère, la pollution, l’envahissement de l’automobile, l’absence de poésie dans le monde, bref, tous ces malaises engendrés par la société. Dans un geste guidé par la pitié, la Koonin venue parlementer avec Félix le tuera plutôt que de lui avouer que sa société n’est pas meilleure que la sienne. Il y a dans cette nouvelle un doux désespoir, une tendresse aussi dans l’avant-dernier tableau, des sentiments très humains qui en font un récit sensible, touchant et réussi.
La meilleure nouvelle du numéro appartient peut-être à Louis-Philippe Hébert avec « Répondre aux questions D-C9 à D-C13 ». « À chaque travailleur correspond une occupation adéquate. » proclame la publicité d’une entreprise où se présente le personnage pour y postuler un emploi. Le lecteur se rend finalement compte qu’il s’agit d’un robot et que son travail consiste à remplir des formules pour postule un emploi. La chute est excellente et l’auteur insère ici et là des détails qui en disent long sur le type de société dans laquelle évolue le personnage-robot. Mais la plus agréable surprise est de constater que le langage de Hébert est très accessible, ce qui ne manque pas de surprendre après avoir lu son introduction. La même remarque s’applique à l’autre nouvelle de Hébert, même si l’auteur y décrit une espèce animale qui emprunte ses caractéristiques aux marsupiaux mais qui n’existe pas en tant que telle. Ce récit est typique de l’œuvre de Hébert.
Les trois courtes nouvelles de Des Roches sont également intéressantes même si je retiens particulièrement « Et, après une nuit de veille ». L’auteur fait montre d’un humour corrosif, d’un cynisme désabusé dans un climat de violence qui m’a rappelé le film de Alan Arkin, Petits Meurtres sans importance. À la vue d’une adolescente qu’il désire, le personnage principal dit : « Je fonds de plaisir et je fonds de douleur : ce doit être ça la rémission des péchés ! » (p. 114). Ce n’était pas tout à fait ce qu’il avait imaginé.
Sur des idées de base toute simples, Bertrand Bergeron a élaboré deux nouvelles dignes d’attention. Dans « Surveillants et détenus », Bergeron met en scène deux groupes, les surveillants et les détenus, dont chaque membre est identifié différemment par l’emploi de la majuscule : surveillant, surveillanT, Détenu, déTenu, etç. dÉtenu s’évade de sa prison et s’enfuit vers la ville. Il voudra bien revenir dans sa cellule parce que ce qu’il y a vu
Dans « Strip-Tease », l’auteur raconte l’histoire d’une femme qui ne parvient pas à se déshabiller. Elle a toujours un gilet et un collant en dessous, comme autant de pelures superposées. Cette nouvelle appartient plus à mon avis, au fantastique qu’à la SF, comme c’est le cas aussi pour « GNAN » de Johanne de Bellefeuille qui met en scène un monstre à tête humaine qui se promène dans les conduites d’eau et a une prédilection pour les renvois d’eau de baignoire.
Avec « Une relation oubliée », Germain-Guy Beauchamp tient une gageure en utilisant le vieux français de la Nouvelle-France. En effet, il nous donne à lire sept feuillets écrits par le père Valois en 1663. Le Jésuite y raconte une rencontre qu’il a eue avec les extraterrestres. Si vous n’avez pas étudié en histoire ou n’avez pas lu des textes de cette époque, il y a de fortes chances pour que vous perdiez les détails de cette relation (écrite et sexuelle).
« Orgone 13 » prouve que son auteur, Jérôme Elie, est capable d’écrire des choses compréhensibles quand il le veut. L’intrigue est originale mais la fin de la nouvelle nous laisse sur notre appétit. On croirait qu’il ne s’agit que d’un extrait qui appellerait une suite aux questions que se pose Finn.
« Ça luit et ça mange », de Hughes Corriveau fonctionne comme les nouvelles de L.-P. Hébert. Corriveau entretient l’ambiguïté, le mystère, de sorte qu’à la fin le point de vue change : le témoin devient le gibier, la proie.
Enfin, Jean-Pierre Vidal regroupe sous un même titre « Cinq ou six morceaux en forme de poire d’angoisse », à recoller précautionneusement, six fragments qui n’ont aucun lien entre eux. Le seul qui présente un certain intérêt concerne le tournage et la projection d’un film porno tels que vus par un narrateur qui n’appartient pas à l’espèce humaine. C’est amusant ! L’homme est toujours présenté, chez Vidal, sous un point de vue qui ne vient pas d’un congénère, ce qui en fait une curiosité ou une anomalie de la nature.
En résumé, le numéro 79-80 de La Nouvelle Barre du jour confirme le talent d’auteurs connus dans le milieu de la SF et attire notre attention sur de jeunes écrivains qui apprennent leur métier. Je pense qu’il faudra surveiller le cheminement de Bertrand Bergeron et de Jérôme Elie, deux nouveaux venus. Une autre conclusion à tirer de ce numéro, c’est que la distinction entre la SF et le fantastique est parfois difficile à faire et que le classement est une affaire de personnalité et d’individu.
Pour commander ce numéro de La Nouvelle Barre du jour :
La Nouvelle Barre du jour, C. P. 131, Succ Outremont, OUTREMONT, Qué., H2V 4M8
Le numéro 79-80 (Science-Fiction) se vend $6.
Claude JANELLE