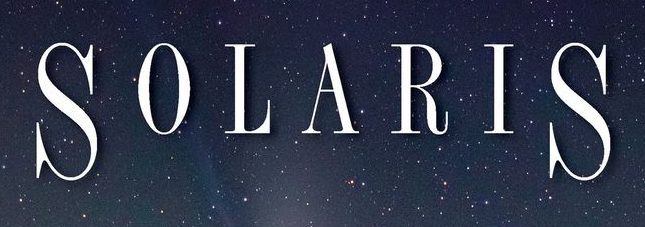Louis-Philippe Hébert, Récits des temps ordinaires (Hy)
Louis-Philippe Hébert : une nouvelle définition du fantastique
Si je m’étais écouté, j’aurais mis de côté le livre de Louis-Philippe Hébert, Récits des temps ordinaires, après la deuxième ou la troisième nouvelle de ce recueil. Et je m’en serais félicité toute ma vie. Mais voilà, il fallait que je le lise au complet pour pouvoir en dire tout le bien ou tout le mal qu’il mérite. Vraiment, faut le faire ! En fait, j’ai accumulé tellement de rancœur en lisant ce livre (surtout au début) que j’ai pensé sérieusement à le brûler moi qui voue à mes livres une dévotion et un soin religieux. C’est vous dire toute la colère que je nourris contre cette œuvre qui a failli me rendre fou.
Au début, j’ai grincé des dents alors que je butais sur le sens incompréhensible d’une phrase, d’une situation. Je ne me rendais pas compte, alors, que je cherchais à comprendre l’incompréhensible, à voir l’invisible, à entendre l’inaudible. Il n’y a rien à comprendre dans ce foutu livre parce que Récits des temps ordinaires est un livre tout à fait irrationnel sur un phénomène tout aussi irrationnel : le fantastique. Quand on a saisi cela, on se trouve dans une meilleure disposition pour aborder cette œuvre bizarre et baroque. C’est peut-être la raison pour laquelle j’ai mieux accepté les dernières nouvelles qui, il faut bien l’avouer aussi, sont plus lisibles, plus cohérentes et plus intelligibles.
En fait, les premières et les dernières présentent un certain intérêt, mais entre ces points culminants il y a un creux de vague duquel on ne peut rien rescaper. Par ces récits insolites, Louis-Philippe Hébert a voulu proposer une forme nouvelle de fantastique. Ses bonnes intentions et sa sincérité ne sauraient être mises en doute mais les résultats sont moches, pour ne pas dire désastreux. Évidemment, le livre d’Hébert a tout pour se rendre détestable : il n’y a pas de paragraphes, la ponctuation est déficiente et même trompeuse, la phrase est excessivement longue au point qu’on perd le fil du récit et le sujet premier de la proposition.
L’auteur conteste le style traditionnel, la syntaxe ordonnée et rigoureuse, la linéarité du récit. Il a bien le droit de faire la guérilla qu’il veut. Si son action vise à définir de nouvelles formes d’expression dans le genre fantastique, tant mieux et bravo… Cependant, si ces formules nouvelles ne réussissent à faire passer aucune émotion que ce soit au lecteur, je me dis que l’auteur s’est mis un doigt dans l’œil et qu’il s’est carrément trompé. Hébert a dynamité le langage traditionnel mais aussi le sens de son récit. Le conte fantastique, plus que tout autre genre littéraire, vaut par sa capacité à nous faire ressentir des émotions et des sentiments.
Or, Hébert ne réussit à peu près jamais à se faire comprendre par son lecteur. Il n’existe aucun lien d’intelligence parce que le récit n’implique pas le lecteur. Comment ressentir de la peur ou de l’anxiété en lisant ces phrases qui n’ont aucun rapport les unes avec les autres ? Parmi ces nouvelles, trop nombreuses sont celles qui sont constituées d’une série d’images incohérentes, gratuites et insignifiantes. Seules quelques-unes, dont « Un tirage au sort », « La Bête plate » et « Les Visites de famille » sont fidèles à une idée de base et se développent sans une certaine unité narrative. Elles réussissent à créer un climat de tension et à faire circuler des émotions.
À mesure que progresse la lecture de Récits des temps ordinaires, il apparaît clairement qu’Hébert ne recherche pas uniquement une nouvelle forme d’expression du fantastique. Il en recherche, dirait-on, une nouvelle définition qui ne soit pas celle, réductible et limitative, du surnaturel et de l’irrationnel. Hébert va plus loin que la description d’événements irréductibles à l’approche scientifique. Il défonce joyeusement ces frontières et met en écriture des faits qui se situent au-delà de l’inexplicable à un point tel qu’en les lisant, on ne les comprendra pas, à cause de notre pensée rationnelle.
Il faut se laisser imprégner d’une certaine folie communicative qui se dégage de ces récits absolument déroutants et consternants. Il faut changer sa méthode de lecture et mettre de côté sa rigueur cartésienne. Cette lecture initiatique ne sera possible qu’à ceux qui auront fait abstraction de leur rationalisme. À ceux-là, Hébert promet la connaissance comme dans La Montagne sacrée d’Alexandro Jodorowski.
Ai-je eu ce privilège ? J’ai peut-être atteint cette essence divine dans quelques nouvelles mais mon manque de foi, comme Saint Pierre, m’a fait caler dans le lac de Tibériade, dans le gouffre de l’incompréhension, pour un bon nombre d’entre elles. Je relis les quelques notes que j’avais rédigées en marge de ma lecture. « Littérature tout à fait exécrable ». « C’est un déchet qui, contrairement aux excréments humains, n’a aucune utilité biologique ». « Nulle alchimie ne pourrait transformer ces fèces en or ». « Les titres n’ont aucun rapport avec ce qui est développé dans ces récits ».
« L’auteur manque de respect envers son lecteur et lui fait perdre son temps comme ce n’est pas possible de le faire ». Réaction excessive, peut-être, mais spontanée.
Avec le recul du temps, mon ressentiment s’est émoussé. Il s’agit de penser aux moments intéressants et à l’interprétation riche que propose « Parallèlement ». Ce récit surréaliste peut signifier bien des choses. J’y ai vu, pour ma part, le symbole de la bombe atomique, de la mort, du hasard et la destruction de l’homme causée par l’homme lui-même. Ou encore cette nouvelle intitulée « La Fourmi extrême », satire assez réussie de la situation dans les hôpitaux et dans les salles d’attente. Et que dire de ce récit « La Paix dans les familles nombreuses » ? De bon ton et de facture presque classique, il propose plusieurs interprétations qui, sans doute, se valent. Le prétexte est simple : des meubles sont accusés d’avoir mangé des membres humains. On les brûle sur la place publique. Puis, on découvre, dans le corps de certaines personnes, des membres dérobés à d’autres individus. Les meubles étaient-ils coupables ? L’auteur dénonce la justice et l’illuminisme de l’homme. Et enfin, cette nouvelle plus réaliste que fantastique, « Un tirage au sort », qui recrée la réalité troublante des clubs de nuit.
Récits des temps ordinaires de Louis-Philippe Hébert est un recueil de nouvelles fantastiques inégal, difficile d’accès, qui propose un nouveau concept en matière de fantastique. Il se veut à l’avant-garde littéraire mais il n’est jamais facile d’être prophète.
Louis-Philippe Hébert
Récits des temps ordinaires
Montréal, Du jour, 1972, 157 p.
Claude JANELLE